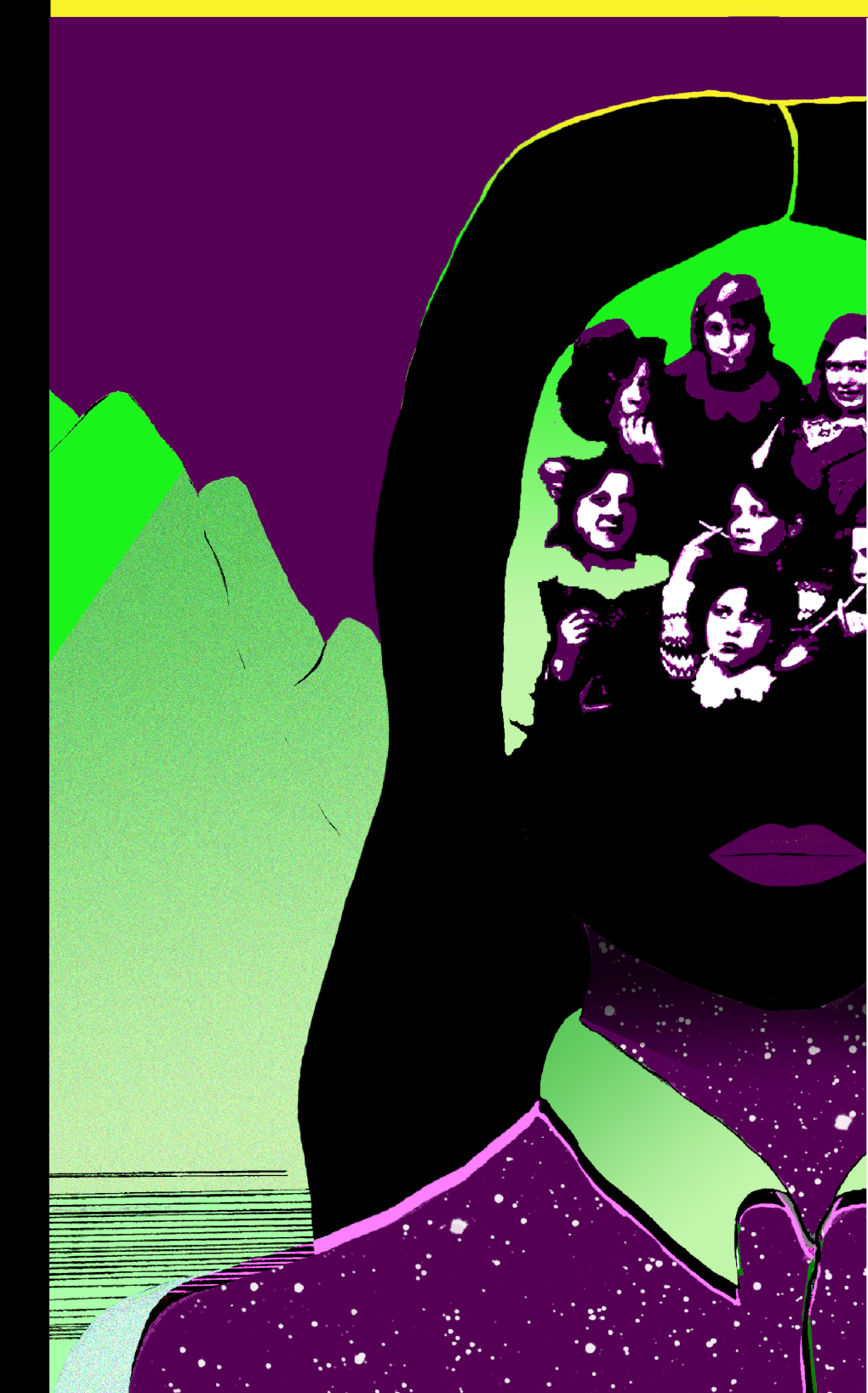Le collectif de femmes de la Maison de la Grève de Rennes organisait en septembre dernier un cycle intitulé : « Penser la différence. Tisser les fils d’une politique des femmes ». Anne Emmanuelle Berger, spécialiste française des études de genre et directrice du Laboratoire d’études de genre et de sexualité, y était invitée pour aborder les notions de visibilité, d’identités et de pouvoir à travers son ouvrage Le Grand Théâtre du Genre. Identités, sexualités et féminisme en Amérique paru aux éditions Belin en 2013. Présentes lors de cette intervention, nous avons transcrit l’intervention d’Anne Emmanuelle Berger fondamentale à nos yeux pour comprendre l’évolution des concepts tels que : féminisme, féminité, théories du genre, phallocentrisme, théorie queer, etc. Transversaux aux mondes universitaires et militants, ces concepts sont abordés suivant les apports multiples de champs tels que la médecine, la psychanalyse, l’anthropologie. En outre, le regard que Mme Berger porte sur le mouvement de libération de la parole des femmes ME TOO lors des échanges avec la salle vient éclairer une situation parfois confuse en mettant à profit la richesse politique que contient sa démonstration.
Transcription de l’intervention d’Anne Emmanuelle Berger du 14 septembre 2019 lors du cycle de la Maison de la Grève "Penser la différence. Tisser les fils d’une politique des femmes".
Ouverture
ALICE : Pour vous présenter, Anne Emmanuelle Berger, vous entamez votre carrière universitaire en France comme professeure de littérature. Vous partez aux États-Unis et y découvrez l’influence de la pensée dite française dans les universités américaines jusqu’à son tournant queer. De retour en France, vous assistez à l’arrivée du queer. Vous êtes directrice du LEGS, Laboratoire d’Étude de Genre et des Sexualités en lien avec le CNRS, Paris 8 et Nanterre. Malgré l’influence de ce que l’on appelle la pensée française, il existe en France, un retard de légitimation de ce champ d’études, le champ des études de genre. Vous dites bien que c’est un champ d’études et pas une discipline. C’est interdisciplinaire. C’est seulement en 2014 que le LEGS est créé en France. C’est le seul laboratoire qui lie explicitement genre et sexualité. Ce que l’on peut lire sur le site du LEGS, c’est que la question des constructions genrées et des rapports de sexe concerne d’une manière ou d’une autre l’ensemble des pratiques sociales et symboliques, publiques et privées, collectives et individuelles. Ce qui requiert donc de la collaboration de savoirs et d’approches multiples. Nous avons retenu de vos travaux qu’il n’y a pas une seule théorie du genre, il y a des théories du genre. On en parlera toujours au pluriel dans un esprit de restitution équitable. L’histoire du développement des théories du genre montre le contraire d’une unicité. D’une certaine façon, c’est aussi ce qui fait leur complexité. Nous l’avons constaté en s’y penchant dessus. Mais aussi, c’est ce qui pourrait le protéger d’un certain dogmatisme. Ce qui nous intéresse, ce sont les ponts que vous construisez avec des points qui paraissent de loin disjoints. On a l’impression que c’est une façon de se positionner qui se rapprocherait de la figure de la tisseuse dont parle Isabelle Stengers en parlant de Donna Haraway. Je vais juste faire une petite citation qui nous faisait penser à vous : « avec la figure du cat’s cradel, le jeu de la ficelle, Haraway appelle ses collègues à ne pas confondre lutte et guerre de position ou de tranchées, mais à pratiquer l’aguet : la reprise transformative de ses motifs, sans rêver de dernier mot. Le geste de reprise n’est pas autorisé par ce qui le reprend, mais parce qu’il est redevable ». C’est dans cet attachement à l’articulation que l’on a sans doute trouvé des réponses a nos tergiversations, c’est-à-dire comment peut-on partir du fait d’être femme sans s’y enfermer ? Avec vous, ce que l’on a envie d’explorer, c’est de comprendre dans quel bain de pensées on a évolué. On a l’impression que l’on pourrait faire une sorte de schéma caricatural pour expliquer dans quoi on baignait avant de s’y pencher sérieusement, on pourrait dire qu’il y avait une approche sociologique de la question portée par les études de genre marqué par la sociologie qui analyserait les rapports sous le prisme de la domination. Un autre point vu était l’approche institutionnelle, le féminisme d’État, la parité, et qui nous semblait directement issu des luttes des années 70. Enfin, plus récemment, la pensée queer qui joue sur les identités sexuelles pour mieux les abolir. Et donc pour nous, partir de la question d’être des femmes était un peu miné dans ces schémas-là. On s’est vite aperçu que tout ça est plus complexe, on l’a vu avec le cycle queer à l’automne dernier, on l’a vu avant-hier avec ce que l’on peut garder comme héritage des années 70 et on veut le voir avec vous ce matin concernant les études de genre. C’est dans l’axe franco-américain que les échanges ont été les plus vifs et les plus intéressants. On perçoit la richesse de ce champ-là avec l’apport de la sociologie, de l’histoire, de la psychanalyse, de la littérature et de la philosophie.
On va revenir sur deux points qui nous paraissent donner des clés de lecture à notre question : dans quel bain de pensées on se trouve, quand on veut partir de la question d’être femme ? C’est l’histoire du genre et le lien entre sexualité, psychanalyse et féminisme. Donc on va commencer avec l’histoire des études de genre, ce que se doivent entre eux, le féminisme, les théories du genre et la théorie queer. Pouvez-vous nous parler de cette histoire jusqu’à son tournant queer ?
ANNE-EMANUELLE BERGER : Je veux d’abord vous remercier de m’avoir invitée. Je suis très heureuse d’être ici, à l’invitation de Blanche et d’Alice et puis à la Maison de la Grève que je ne connaissais pas, mon ignorance témoignant du fossé bien français qui sépare encore Paris et la province ou les provinces. Mais je veux dire d’abord que je suis très admirative du travail que vous faites. Je suis frappée par l’extrême sérieux avec lequel vous vous engagez dans ces questions qui sont effectivement immenses, et puis aussi par votre grande ouverture d’esprit. Et je rejoins Isabelle Stengers (même si mes positions, mes objets, ou mes préférences ne sont pas nécessairement les mêmes que les siennes) lorsqu’elle dit qu’il faut se méfier de tous les conformismes, y compris des conformismes « alternatifs », et qu’il faut résister aux définitions figées.
Sur ces mots, je vais tenter de répondre à vos questions dans la mesure de mes capacités, et, bien entendu, si le langage que j’emploie n’est pas clair pour vous , n’hésitez pas à m’interrompre à tout instant. Ça, c’est ce que l’on fait aussi quand on est prof, ce qui est mon métier. Ça ne me dérange pas d’être interrompue, de répéter, de dire autrement et de reprendre.
Une histoire des études de genre
Je commence. En ce qui concerne l’histoire des études de genre et des théories (au pluriel) du genre, la distinction ou plutôt la disjonction — je distingue entre distinction et disjonction — épistémologique et méthodologique entre sexe et genre a d’abord été proposée dans les années 1950 par des médecins travaillant sur le problème de ce que l’on appelait alors l’hermaphrodisme et qu’on appelle aujourd’hui l’intersexualisme. L’un des premiers à formuler et théoriser cette disjonction, John Money, était un pédiatre endocrinologue spécialisé dans la question de l’hermaphrodisme et du pseudo-hermaphrodisme. On distingue, dans le milieu médical, les formes d’hermaphrodisme caractérisées d’autres formes de confusion biologique des marqueurs de sexe que l’on appelle pseudo-hermaphrodisme. Mais sur le plan social et symbolique, cela revient au même. John Money s’intéressait au développement physiologique et psycho-sexuel d’individus dits hermaphrodites qui présentaient donc un trouble de l’alignement entre sexe gonadique, sexe chromosomique, sexe hormonal et sexe anatomique, tous ces éléments rentrant en compte dans la définition biologique du sexe mâle ou femelle. Quelques années plus tard, c’est Robert Stoller, médecin et psychanalyste, qui reprendra la distinction entre sexe et genre pour essayer de penser et de traiter un autre phénomène de trouble de l’identité sexuelle, le transsexualisme. Vous le savez peut-être, la notion même de transsexualisme date du milieu du XXe siècle. Elle a accompagné les premiers essais de traitements chirurgicaux de ce que l’on appelait alors les dysphories de l’identité sexuelle. En français, le mot « transsexualisme » est attesté à partir des années 1960 ; il est donc assez récent. C’est un mot qui nous vient bel et bien des États-Unis, comme, il faut le dire, une grande partie du lexique touchant à la sexualité et au genre au XXe siècle. Au départ, quand on parle de transsexualisme, ce que l’on désigne, et ce qui intéresse Robert Stoller d’un point de vue psychanalytique, c’est le transsexualisme Male to Female, et non le transsexualisme Female to Male, qui n’est guère observé à cette époque, alors qu’il semble dominer aujourd’hui, en Occident. C’est dire aussi à quel point les questions touchant à la sexualité et aux identités dites sexuelles sont contingentes, et fortement situées, pour reprendre un terme qui a circulé hier. C’est-à-dire qu’elles dépendent pour une bonne part de contextes historiques, culturels et politiques spécifiques.
Le phénomène de l’intersexualisme met en échec la catégorisation binaire des sexes qui est censée fonder à la fois physiologiquement et sociologiquement la partition homme-femme. Le genre de l’individu intersexuel ne peut en effet être déduit de ses seules caractéristiques sexuelles. C’est ce qui a fait dire à la biologiste féministe américaine Anne Fausto-Sterling, de façon délibérément provocatrice, qu’il n’y a pas deux sexes, ni même trois, mais cinq, puisqu’il y a sur le plan biologique et clinique différentes formes d’intersexualisme, donc différentes formules de composition sexuelle d’un individu intersexuel. Le transsexualisme quant à lui, désigne, vous le savez, la disjonction entre le sexe de naissance, c’est-à-dire plus précisément le sexe reconnu ou assigné à la naissance, et le genre revendiqué par le sujet transsexuel. Intersexualisme et transsexualisme mettent donc en question la coïncidence naturelle entre sexe et genre. Comme vous le savez peut-être, le mot « nature » vient du verbe latin nascior, natus sum, qui veut dire naître ou être né. La nature, c’est, littéralement, ce qui est donné avec et par la naissance.
Disjonction sexe/genre
Intersexualisme et transsexualisme mettent en question la coïncidence naturelle, la coïncidence native ou d’origine, entre sexe et genre. L’un et l’autre obligent donc à penser non seulement la distinction entre sexe et genre, mais bien leur disjonction. Alors, certes, on peut dire que nous avons affaire ici à des anomalies ou des pathologies de la division sexuelle, statistiquement négligeables, mais on peut aussi, comme le fait toujours la science, partir de ces exceptions apparentes à la règle commune pour commencer à réfléchir sur l’énoncé de cette règle, sur les modalités et les effets de son établissement ou de sa formulation. C’est bien ce qu’ont tenté de faire un certain nombre de penseuses et penseurs travaillant dans le champ des études de genre aujourd’hui. Mais dès les premières formes de théorisation de la disjonction entre sexe et genre, il y a eu divergence entre ses promoteurs. Money et Stoller, dont je vous parlais à l’instant, s’accordent pour ne pas opposer nature et culture. En anglais on dit plutôt : nature and nurture. Nurture désigne le fait d’élever en nourrissant, et implique donc un processus de socialisation. En s’accordant pour ne pas opposer nature et culture, autrement dit biologie et psychosociologie, Money et Stoller cherchent à montrer comment les unes et les autres interagissent et influent l’une sur l’autre de telle manière qu’elles deviennent inextricables. La pensée féministe s’est longtemps méfiée de cette interaction, mettant au contraire l’accent sur la rupture épistémologique radicale entre nature et culture. Mais on revient aujourd’hui à une formulation moins oppositionnelle, moins disjonctive du rapport entre nature et culture. Cependant, leurs conceptions du genre et leur façon de théoriser la disjonction sexe/genre diffèrent nettement. Money considérait le genre non pas comme une disposition innée, mais comme un rôle social joué par le sujet, un comportement réglé selon une partition apprise, identifiable et reproductible. D’où ses tentatives de régler le problème des intersexes par la réassignation de sexe et par la socialisation délibérée dans un genre et un seul. Pour Money, la notion de rôle précède ainsi épistémologiquement la notion d’identité. Là, où nous avons tendance à penser de façon spontanée l’identité comme ayant avoir avec les caractéristiques intrinsèques d’un.e individu.e, la notion de rôle implique l’interaction avec autrui et suggère la préséance du social, en l’occurrence de la personne publique et de l’affichage public sur l’intériorité psychique. Money définit le genre ainsi : « Tout ce que l’on dit ou fait pour manifester son statut de garçon ou d’homme, de fille ou de femme ». On peut rattacher la perspective de Money à certains courants fondamentaux de la sociologie états-unienne du XXe siècle. Vous avez peut-être entendu parler du sociologue Ralph Linton. Il est le promoteur de ce que l’on a appelé la role theory. La théorie des rôles invite dès les années 1930 à penser les rapports sociaux comme des rôles. La role theory insiste comme son nom l’indique sur l’idée que nous jouons tous.tes des rôles en société, au double sens qu’a le terme. Au Moyen-âge, le mot « rôle » désigne déjà une fonction propre à une personne dans la société, mais c’est d’abord un rouleau, un roll. C’est ça, au début, un rôle, c’est un rouleau qui était déplié par les crieurs publics sur la place des villes et des villages et sur lesquels étaient écrits les édits du roi ou des pouvoirs locaux ; édits que les crieurs proclamaient pour les porter à la connaissance du public. Ce rouleau imprimé devient ensuite une partition, un texte confié à et appris par un acteur de théâtre. Le genre, dans cette perspective, désigne ainsi l’ensemble des rôles que nous jouons, c’est-à-dire que nous sommes amené.e.s à apprendre et à jouer publiquement en tant qu’hommes ou femmes, ou plus exactement pour établir notre statut d’hommes ou de femmes. Toute la sociologie états-unienne du XXe siècle s’inscrit dans le sillage de la role theory, contrairement à la sociologie européenne qui est plutôt une sociologie des classes ou des organisations, donc une sociologie des groupes. La sociologie états-unienne et en particulier la sociologie dite de l’interaction sociale qui est la principale école de sociologie américaine au XXe siècle s’est en effet surtout intéressée à la formation et à la présentation du moi social, le social self, à travers l’étude des modalités codées des interactions entre les individus. Vous avez peut-être entendu parler d’un des sociologues américains les plus connus, représentatif de cette école de l’interaction sociale qui s’appelle Erving Goffman. Parmi les premiers textes qu’il a écrits et qui l’ont lancé, il y a le livre qui s’intitule : The Presentation of Self in Everyday Life (La présentation de soi. La mise en scène de la vie quotidienne). Ce livre date lui aussi des années 1950. La sociologie de l’interaction sociale s’est très tôt focalisée sur les modes d’apprentissage des conduites masculines et féminines, donc sur le genre comme élément majeur de la présentation et de la formation du moi social. On voit bien ici la proximité de la sociologie américaine qui est, par bien des aspects, une sorte de psychologie sociale avant la lettre, avec la psychologie comportementaliste.
Mais pour Stoller, contrairement à Money, le genre est un noyau du moi qui surdétermine les interactions sociales, autrement dit, qui informe le processus de socialisation autant qu’il résulte de celui-ci, même si le Moi en termes psychanalytiques est aussi le fruit d’une interaction avec autrui. Le « Moi » dit Freud à plusieurs endroits (voir par exemple Le Moi et le Ça), est la résultante, la somme de ses identifications. Stoller travaille à partir d’un paradigme freudien même si, dans sa théorie du transsexualisme — et plus exactement, comme je vous le disais tout à l’heure, du transsexualisme M to F, Male to Female, qui était donc le seul identifié et labellisé en tant que tel à l’époque— , il prend en quelque sorte le contre-pied des thèses de Freud. Freud affirme que, dans la prime enfance, la petite fille, active en tous points, est un petit homme. Autrement dit, pour Freud, tous les enfants, qu’il qualifie par ailleurs de « pervers polymorphes » parce que leur sexualité et leur identité sont labiles, sont d’abord des petits garçons. C’est progressivement (et non sans souffrance ni difficulté) que la fille va adopter une position et une conduite féminines. Partant de la question du transsexualisme Male to Female, Stoller tire des conclusions opposées à celles de Freud. Ce qui montre au passage que la psychanalyse n’offre pas un corps de doctrines unifié. À l’intérieur même du champ de la pensée psychanalytique, et depuis ses débuts, on a beaucoup discuté, disputé et pris des positions très différentes à l’égard des problèmes à la fois cliniques et théoriques rencontrés. Donc Stoller, au contraire de Freud, émet l’hypothèse qu’au départ tous les enfants seraient des petites filles, si l’on peut dire, et que le transsexuel serait quelqu’un qui n’a pas réussi à se détacher de la mère, à se désidentifier d’elle dans la petite enfance. D’où un trouble de l’identité sexuelle. Ainsi, et pour en revenir à mon propos principal partant d’un espace épistémologique et clinique différent de celui de Money, Stoller aboutit à des formulations différentes. Vous voyez que dès le noyau épistémique de départ, la compréhension et la théorisation du genre a emprunté des chemins potentiellement divergents. Les médecins et psychosociologues qui ont formulé les premières théories du genre n’étaient pas des révolutionnaires ou des gens désireux de remettre en question l’ordre établi. Ils avaient devant eux des êtres humains en souffrance et essayaient à la fois de comprendre cette souffrance et de la traiter. Money, qui traitait des enfants, se posait plus particulièrement la question de la socialisation des jeunes intersexuels, d’où ses tentatives de les faire rentrer dans la catégorie homme ou dans la catégorie femme afin d’en faire des êtres normaux et reconnus comme tel. Et pour cela, il cherchait à aider les parents à élever leurs enfants comme une fille ou comme un garçon.
Ordre sexuel et système de genre
On sait aujourd’hui que ce sont précisément ces tentatives de faire rentrer les intersexes dans un ordre culturel rigidement binaire et dans l’ordre sexuel « normal » qui a pu causer dans certains cas de terribles ravages psychologiques chez ce type de patient. Par « ordre sexuel », j’entends à la fois la mise en ordre des sexes — qui n’est pas simplement la conséquence du dimorphisme biologique, mais ressortit plutôt à l’interprétation de celui-ci, à son traitement à la fois systémique et normatif, autrement dit, à son inscription dans un système de genre— et l’ordre (ou la mise en ordre) de la sexualité. Ces deux ordres sont liés. L’intersexualité, en produisant un trouble dans l’identité sexuelle, engendre du même coup un trouble de ce que l’on appelle l’orientation sexuelle. Donc, question de genre, question de sexualité. On essaye aujourd’hui de traiter autrement l’intersexualité, quand du moins on la détecte ou la désigne comme telle. Ce qui même aujourd’hui n’est pas toujours le cas. Je pense à l’histoire à rebondissements relativement récente de Caster Semenya dont vous avez certainement entendu parler dans les journaux. Il s’agit d’une athlète sud-africaine qui a été, à la naissance, identifiée comme femme et qui, en fait, « souffre » d’une forme d’hyperandrogénie, ce que l’on appelle techniquement un pseudo-hermaphrodisme. Elle a été championne olympique du 800 mètres femme, mais a ensuite été mise en cause pour « concurrence déloyale » au motif qu’elle serait en réalité un homme. J’ai vu que récemment, on vient de lui interdire de concourir avec les femmes à la suite de sa mise en cause par ses concurrentes. On a découvert tardivement l’intersexualisme de Caster Semenya, qui par ailleurs se définit, sur le plan de la sexualité, comme lesbienne.
Pourquoi je vous raconte toute cette histoire ? Pour vous rappeler que contrairement à ce que l’on pourrait croire, ce n’est pas la pensée féministe, née des mouvements de libération des femmes en Occident dans les années 1970 qui a introduit la notion de genre tel qu’elle a cours aujourd’hui. Ce n’est pas elle qui a proposé ni même théorisé la première, je viens de le rappeler, la distinction épistémologique et méthodologique entre sexe et genre. Celle-ci n’a d’ailleurs pris un sens féministe qu’avec l’introduction de la question de la hiérarchie entre les sexes et de ses effets d’inégalité, donc avec la réinterprétation de la disjonction entre sexe et genre comme distinction entre le dimorphisme biologique d’un côté et la dissymétrie hiérarchisante entre les sexes, effet d’un « système de genre », et tel que les rapports de genre apparaissent finalement comme des rapports de pouvoir. Une telle perspective était absente des premières formulations dans ce domaine, même si quelqu’un comme Erving Goffman est un des tout premiers sociologues du genre à s’être approché du problème en traitant des hiérarchies de genre au sein de la famille et en émettant en particulier l’hypothèse que la relation mari-femme aurait en fait pour modèle la relation parent/enfant. C’est une hypothèse que l’on trouve en réalité déjà formulée dans Le Deuxième sexe de Simone de Beauvoir, mais qui est fortement inscrite dans l’imaginaire culturel nord-américain ordinaire. Très souvent, au sein des couples, l’homme appelle la femme « baby », « my baby ». Donc mari/femme = parent/enfant.
La relance féministe
J’en arrive maintenant à la façon dont la distinction à la fois méthodologique et épistémologique entre sexe et genre a été reprise et relancée par les théoriciennes féministes. Les deux premières théoriciennes féministes du genre, et de la distinction entre sexe et genre, sont la sociologue britannique Ann Oakley et, d’autre part, Gayle Rubin qui était alors une jeune anthropologue américaine, élève de Marshall Sahlins, disciple états-unien de Lévi-Strauss, très connu aux États-Unis. Oakley et Rubin se sont d’ailleurs appuyées l’une comme l’autre, et sans s’être donné le mot, sur l’œuvre de Lévi-Strauss pour théoriser la distinction entre sexe et genre. Dans son essai inaugural qui s’intitule en anglais The Traffic in Women : Notes on the Political Economy of Sex (Le trafic des femmes, le marché des femmes, notes pour une économie politique du sexe), essai qui a paru en 1975, c’est-à-dire en plein moment MLF ou Women’s Lib aux États-Unis, Rubin livre l’une des premières définitions féministes du genre conçu comme « une division socialement imposée des sexes ». Elle pense la distinction entre sexe et genre, dans le sillage de Lévi-Strauss, comme coïncidant avec l’opposition entre nature et culture. Rubin se sert de l’explication par Lévi-Strauss des modalités de conversion des besoins ou dispositions naturelles en comportements réglés pour penser le passage, mais aussi le saut qualitatif, du sexe au genre : encore une fois, d’un état ou d’une fonction présumés naturels à un ou des états de culture. Mais cela veut dire aussi que genre et sexe demeurent liés dans cette perspective. De même que la culture travaille un matériau naturel déjà donné si l’on peut dire, le genre est présenté comme la transformation sociale d’une « sexualité » que Rubin qualifie de biologique dans son origine. Ce n’est pas un chapitre que je vais ouvrir maintenant, mais je pense qu’un des glissements qui n’a pas été suffisamment pensé, et qui prête à confusion, c’est la façon dont, à l’intérieur du champ féministe et pour des raisons qu’il faudrait développer, on a réinterprété la notion lévi-straussienne de « nature », que lui-même emprunte à Rousseau, en termes de « biologie ». Or, chez Rousseau de toute évidence, mais aussi chez Lévi-Strauss, nature ne signifie pas nécessairement biologie, au sens que nous donnons à ce terme et au domaine scientifique qu’il indexe aujourd’hui. On a surimposé et confondu entre elles si vous voulez, les notions de nature, de biologie, de corps, etc., et cela a entrainé la pensée féministe dans une certaine direction. Chez Rubin en tout cas, le genre est présenté comme la transformation sociale d’une sexualité que celle-ci qualifie de biologique dans son origine. Le genre désigne donc la forme sociale et les manifestations culturelles de l’appartenance de sexe. C’est ce qu’en France, on désignait naguère sous le nom de rapports sociaux de sexe. Rubin analyse la dissymétrie des rapports de genre à partir des modalités et des règles de l’échange des femmes selon l’explication qu’en donne Lévi-Strauss dans Les structures élémentaires de la parenté, thèse de Lévi-Strauss publiée pour la première fois en 1949 c’est-à-dire exactement au moment où de Beauvoir publiait Le Deuxième sexe. Lévi-Strauss doit à un autre grand anthropologue et sociologue de la première moitié du XXe siècle, Marcel Mauss, sa conception de l’échange comme opérateur princeps du lien social. Mauss a écrit un célèbre essai qui s’appelle : Essai sur le don : dons et échanges dans les sociétés archaïques, dans lequel il explique que les sociétés archaïques fonctionnent sur le mode de l’échange et que c’est l’échange qui crée du lien social. Et Mauss parle de toute sorte de formes d’échanges et d’objets échangés. On échange des coquillages qui ont une valeur symbolique dans certaines tribus mélanésiennes, mais on échange aussi, un peu partout, de la nourriture. Mauss signale enfin que, de la même manière, on échange les femmes. Et ce, à la fois dans les sociétés dites archaïques, mais aussi dans les sociétés pré-modernes puisque, vous le savez, —et on en a longtemps gardé des traces culturelles au moins jusqu’à la fin du XIXe siècle en Occident—, les femmes étaient données en mariage, par le père généralement. Or, Lévi-Strauss a fait de l’échange des femmes le paradigme même de l’échange social, de tout échange social en essayant de montrer dans Les structures élémentaires de la parenté que c’est l’échange des femmes qui fonde le social. Pourquoi ? Parce que quand vous échangez des femmes, vous créez de l’alliance entre les clans ou entre les familles. Lévi-Strauss doit à Marcel Mauss sa conception de l’échange comme opérateur de lien social . Pour Lévi-Strauss, c’est plus qu’un opérateur, c’est le générateur, le fondement même du lien social. Et contrairement à Mauss, c’est l’échange des femmes et par conséquent les règles matrimoniales qui servent à codifier celui-ci, qui constitue pour Lévi-Strauss la pièce maîtresse de cette opération. Or, les hommes ont été traditionnellement les agents et les bénéficiaires de ce dispositif de l’alliance (c’est ainsi que Foucault nomme l’échange des femmes) et les femmes les objets échangés. Cette dissymétrie permet à Rubin de penser le genre comme une structure et non comme un attribut ou une qualité, fût-elle sociale, et pas seulement comme une structure différentielle, mais comme une structure hiérarchique. C’est la grande nouveauté par rapport à l’approche de Money et Stoller qui ne s’intéressaient pas du tout aux effets de hiérarchie et de subordination engendrés par la dissymétrie sociale des positions des femmes et des hommes.
De la French Theory et de la Gender Theory
Ainsi, pour que la gender theory, la théorie du genre, devienne une théorie féministe ou apparaisse comme telle, il a fallu qu’émerge le mouvement de libération des femmes comme mouvement social, mais il a fallu attendre aussi la découverte dans l’université américaine et britannique d’un continent de pensée européen, qu’on a nommé la French Theory. La pensée française a constitué la pointe la plus avancée de la gender theory comme en témoigne la mise à contribution, dès sa réception, de l’Anthropologie structurale de Lévi-Strauss qui a constitué une source de réflexions majeures (et ce n’est pas la seule), pour la pensée féministe naissante. Le privilège accordé au mot « théorie » tel qu’il circule dans le monde anglophone et maintenant en Europe, signale le lien historique et intellectuel entre la gender theory et particulièrement son développement queer et leur contemporaine et modèle aux États-Unis, la French Theory, cette pensée française transdisciplinaire qui a irrigué sous ce nom les travaux menés dans le champ des humanités et des sciences humaines dans l’université américaine entre les années 1970 et le début des années 2000. (Remarquez que, dans la formule French Theory, le mot « theory » est employé en construction absolue ; ce n’est pas la théorie de quelque chose — de l’évolution, du genre, etc.,-mais la théorie tout court. Comme quand la Phèdre de Racine dit, non pas « j’aime Hippolyte », mais « j’aime », tout court. C’est ça, une construction absolue : elle n’a pas d’objet défini, parce que la théorie, ou l’amour dans le cas de Phèdre, sont à eux-mêmes leur propre objet.) Mais de même que, sous le nom de French Theory, ont circulé aux États-Unis des œuvres et des courants de pensée variés et hétérogènes, de même, sous l’appellation de « gender theory », se sont élaborées des théories diverses. En langue anglaise, beaucoup de mots au singulier ont valeur de collectif. Il n’y a pas la même partition entre pluriel et singulier qu’en français. Donc ce que l’on appelle gender theory ne doit pas être interprété, comme on le fait parfois ici de façon tendancieuse, en brandissant l’épouvantail de la théorie du genre comme si cette formule recouvrait un corps de doctrines homogènes. Sous ce nom, ce sont en réalité des propositions théoriques et des positions épistémologiques diverses, voire divergentes qui sont rassemblées et discutées. À partir de cette rencontre entre des traditions épistémologiques anglo-américaines et ladite pensée française, la distinction sexe/genre a fait l’objet de réappropriations diverses sinon divergentes selon que la perspective féministe informant ce processus de réappropriation était marxiste, structuraliste, voire, comme chez la penseuse nord-américaine Gayle Rubin dont je vous parlais, marxiste et structuraliste (à ses débuts du moins) ou encore post-structuraliste ou même libérale au double sens qu’a ce dernier terme aux États-Unis, avec par exemple quelqu’un comme la philosophe Martha Nussbaum ; selon encore que cette réappropriation était ou non marquée par les théories comportementalistes américaines auxquelles j’ai fait allusion, et plus généralement par la sociologie de l’interaction sociale ; selon enfin qu’elle se formulait à partir d’une expérience de la sexualité majoritaire ou minoritaire, normative ou « déviante ». Le marxisme, le structuralisme, le post-structuralisme ne sont pas des courants de pensée made in America. On ne peut donc pas dire que les études de genre qui sont la résultante de toute l’histoire que je viens de brosser à grands traits soient une invention et une importation américaine. Les théories qui se côtoient ou se confrontent à l’intérieur de ce champ de recherche sont le produit non pas de la convergence, mais comme je l’ai dit, de la rencontre de traditions épistémologiques américaines et européennes à la faveur de la diffusion massive dans le monde universitaire américain de travaux de philosophes, d’anthropologues ou de psychanalystes européens et particulièrement français relevant dans leur majorité de ce que l’on a appelé le structuralisme puis le post-structuralisme. Les grands représentants en France du structuralisme sont justement Lévi-Strauss, qui a d’ailleurs écrit un livre qui s’appelle Anthropologie structurale, et puis quelqu’un qui s’est inscrit au moins au départ dans son sillage, Jacques Lacan, psychanalyste français. Il y en a d’autres aussi, et il faut dire que le structuralisme est né de la linguistique, de la linguistique théorique, telle qu’elle a été élaborée par Ferdinand de Saussure au début du XXe siècle. La révolution saussurienne a consisté à montrer que le langage, justement, était une structure, et plus précisément une structure différentielle. Ce qui fonde l’articulation linguistique, c’est la possibilité de distinguer phonologiquement entre voyelle et consonne, mais aussi entre voyelle et voyelle, etc. De même, le sens est conçu par Saussure comme un produit des différences sémantiques. Même si toutes les distinctions ne sont pas de l’ordre l’opposition, blanc n’a de sens que relativement à noir, femme que relativement à homme, etc. Mais on distingue aussi entre marcher et courir, entre le jaune et le vert, etc. Le structuralisme a fait prendre à toute la pensée qui s’est développée dans son sillage un tournant que l’on a appelé aux États-Unis de manière rétrospective the linguistic turn (le tournant linguistique), c’est-à-dire on s’est mis à penser toutes sortes de questions dépassant largement le champ du langage et de la réflexion sur le langage à partir d’un modèle épistémologique et d’un modèle interprétatif qui était celui de la linguistique saussurienne. Celle-ci a produit d’autres grands représentants d’une linguistique structurale comme Roman Jakobson, sur lequel se sont appuyées les philosophes féministes italiennes du collectif Diotima, lesquelles étaient liées au collectif de La librairie des femmes de Milan auquel certaines d’entre vous se sont intéressées.
Les vagues féministes
Après son invention par Money et Stoller, la théorie du genre a donc été appropriée et reformulée par la pensée féministe dite de la deuxième vague, c’est-à-dire celle qui commence à la fin des années 1960. On parle de « deuxième vague » par rapport à une « première vague » féministe presque totalement oubliée. Mais c’est le sort de toutes les vagues si l’on peut dire, car l’Histoire est une machine à effacer et non pas comme on pourrait le croire à accumuler et mémoriser. La première vague féministe avait commencé à déferler au début des années 1880 en Europe, et elle a été massive, ce qu’on a oublié. Elle s’est focalisée à l’époque sur la revendication du suffrage universel. Dans différents pays européens, la revendication a abouti plus ou moins rapidement, l’obtention du droit de vote pour les femmes a eu lieu à des moments différents, mais en tout cas ce premier mouvement féministe fut aussi d’un foisonnement extraordinaire. Il y a eu quelqu’un en France que vous connaissez peut-être et qui s’appelle Marguerite Durand. Elle avait fondé avec d’autres, à la fin des années 1890 — le premier numéro date de 1897 —, un journal féministe, un quotidien, qui s’appelait La Fronde, et qui, à l’époque, était tiré à plus de deux cent mille exemplaires. Deux cent mille exemplaires dans la France de la fin du XIXe siècle, c’est énorme. Et à chaque fois (à la fin du XIXe siècle comme durant la décennie MLF), les vagues féministes se sont accompagnées d’une production artistique et intellectuelle intense : il y a eu lors de ladite première vague, du théâtre féministe, qui s’est appelée comme tel ; il y a eu la rédaction de manifestes féministes totalement oubliés aujourd’hui. Ce qui a interrompu ce mouvement et marqué un coup d’arrêt de tout progrès dans ce domaine pendant des décennies, c’est la Première Guerre mondiale.
Après le moment d’appropriation et de reformulation des théories du genre des années 1950 et 1960 par la pensée féministe dite de la deuxième vague, on a assisté à partir des années1980 à un tournant foucaldien à la faveur de la traduction et de la réception dans le monde anglophone de L’histoire de la sexualité de Foucault et surtout du premier volume de celle-ci, La volonté de savoir. Émergent alors d’autres manières de penser le genre. C’est l’historienne Joan Wallach Scott qui emblématise ce tournant. Dans son célèbre article publié pour la première fois en 1986 et intitulé Le genre, une catégorie utile de l’analyse historique, elle se réclame explicitement de Foucault pour penser le genre, même si Foucault ne parle pas de genre et malgré le fait que sa propre manière de faire de l’histoire ne soit pas très foucaldienne, pas du tout même, à mon avis. Néanmoins, sa conception du genre est bien tributaire de la manière dont Foucault a pensé ensemble sexualité et pouvoir. Si vous avez lu L’histoire de la sexualité et plus exactement le premier volume, vous savez que cette histoire de la sexualité est le lieu d’élaboration d’une nouvelle théorie du pouvoir, en l’occurrence d’une tentative de repenser la question du pouvoir en général, et de penser ses formes contemporaines en particulier sous l’espèce du biopouvoir. Le biopouvoir concerne la vie et cible les corps, on voit donc bien le rapport de celui-ci avec la question de la sexualité. Joan Scott, de manière néo-foucaldienne, définira alors le genre comme « une manière primordiale de signifier des rapports de pouvoir ». Ce faisant, elle cherche à faire valoir la dimension politique de la structure et des rapports de genre. Certes, la perspective de Rubin était déjà proto-politique mais je dirais qu’en tant qu’anthropologue, elle est d’abord une penseuse du social et des variations culturelles. Le politique intervient à partir du moment où l’on pose la question du pouvoir et des rapports de force. À partir de Joan Scott, la politisation du genre à la fois comme catégorie et comme concept passe au premier plan. Et parce que le genre est apparu comme un rapport de pouvoir au sein d’un ensemble complexe de rapports de pouvoir, s’est ouvert le champ d’investigation que l’on désigne sous le nom d’intersectionnalité aujourd’hui, soit l’étude de la façon dont différents rapports de domination s’imbriquent les uns dans les autres. C’est la penseuse africaine-américaine Kimberlé Crenshaw, professeure de droit à l’UCLA, qui a lancé le mot en poursuivant l’effort du black féminism de tenir ensemble dans leur tension même l’oppression de sexe et l’oppression de race. Évidemment, toutes ces questions étaient déjà en germe dans les années 1970, aussi bien les questions de ce que l’on traite aujourd’hui au titre de l’intersectionnalité que la question de l’hétérosexisme, du rapport entre genre et sexualité, etc. Mais elles ont été formalisées plus tard, lorsqu’elles ont trouvé un ancrage théorique plus solide, engageant d’ailleurs à chaque fois la pensée et l’action dans des directions différentes. Après Joan Scott, vient dans cette histoire de l’infléchissement et des métamorphoses conceptuelles du genre, le moment queer et particulièrement le moment Judith Butler. Ni les médecins de l’intersexualisme et du transsexualisme, ni vraiment les penseuses féministes dites de la deuxième vague ne mettaient en question la structure binaire de l’ordre sexuel. Comme je l’ai dit, il fallait pour Money et Stoller, quoique dans des termes différents pour chacun, aider les patients en question à rentrer dans la norme afin d’avoir une vie vivable. Cependant leurs travaux sur le genre ont bien ouvert la voie à la pensée queer.
La pensée queer
La pensée queer, pour le dire vite, récuse non seulement la division binaire des sexes, mais même celle des genres. Son élaboration, comme son nom l’indique, a commencé avec l’exploration et la revendication de formes de sexualités et d’identifications genrées minoritaires. Je pense aux travaux de Butler, mais aussi de Teresa de Lauretis, qui est d’origine italienne et qui est celle qui a lancé la notion de pensée queer. Ou encore à quelqu’un comme Eve Sedgwick Kosofsky. Queer, vous le savez sans doute, est un adjectif qui veut dire bizarre ou tordu. C’est un mot banal de la langue anglaise. Si vous lisez des romans anglais ou américains du XIXe siècle ou même du début du XXe siècle, vous trouverez fréquemment le mot queer (je pense par exemple à des auteur.e.s aussi différent.e.s que Charlotte Brontë au XIXe siècle et Richard Wright au XXe siècle, qui font chacun grand usage de cet adjectif). Il n’y a pas de connotation sexuelle ou sociale particulière attachée à ce moment-là à son usage. C’est à partir du début du XXe siècle, c’est-à-dire au moment où a émergé la notion à la fois clinique et sociale d’homosexualité et la figure culturelle de l’homosexuel que le mot a commencé à être employé pour désigner de façon oblique et péjorative les homosexuels. Il a ensuite été réapproprié par la pensée queer en un mouvement de réappropriation et de retournement du stigmate en quelque chose de positif. Donc, pour ce courant de pensée, la notion même de genre, dans la mesure où elle signale la rupture du lien organique et logique avec le sexe, jette bien le trouble dans l’ordre des sexes et des sexualités. Dès lors que l’on passe avec le genre (et grâce à lui) au-delà du sexe et de la binarité sexuelle, on passe alors, bon gré mal gré, selon les théoriciens et les théoriciennes queers, du côté de ce qui a été appelé la multitude queer. En ce sens, le genre n’est pas seulement une catégorie d’analyse, il a été indéniablement un instrument, sinon l’instrument notionnel principal de la queerisation des études féministes. Et c’est pourquoi, même si dans certaines de ses incarnations la pensée queer préconise l’abandon du paradigme du genre en faveur de celui de la ou des sexualités, elle n’en reste pas moins redevable et rattachée intellectuellement et politiquement à celui-ci. Et ce n’est donc pas un hasard si les figures les plus en vue aujourd’hui du féminisme et du post-féminisme américain, en tous les cas sur son versant intellectuel, sont ou étaient des figures queers, c’est-à-dire des lesbiennes plus ou moins déclarées. Je vous parlais de Butler, mais on peut citer à ce titre aussi Gayle Rubin, Teresa de Lauretis, ou encore Janet Halley avant que cette dernière ne se mette explicitement en congé du féminisme. Je caractériserais le féminisme queer comme un féminisme autocritique, puisqu’il passe par la critique de ce que Butler appelle : « le sujet du féminisme », soit l’idée selon laquelle le féminisme renverrait aux femmes et à la femme comme si « femme » était une notion unifiée, non problématique, etc. Et c’est pourquoi un certain récit généalogique rapportant l’émergence de la gender theory aux premiers travaux américains sur l’intersexualisme et le transsexualisme, dont on comprend bien dans cette perspective la valeur heuristique et l’importance stratégique, c’est pourquoi, donc, ce récit a bien cours aujourd’hui au sein même des études de genre. C’est le récit des origines le plus courant à l’heure actuelle, signe de la queerisation du champ de la pensée féministe. Quant à Butler, l’une des raisons de l’impact politique et intellectuel de son intervention théorique tient à sa manière habile de faire fond sur toutes les tentatives disponibles, toutes traditions intellectuelles confondues, de penser la disjonction entre sexe et genre. En pensant le genre, à l’aide de la psychanalyse, comme une résultante des modalités d’institution dans les sujets ou pour les sujets d’une hétérosexualité sinon obligatoire du moins hégémonique, elle a contribué de manière décisive à queeriser le champ théorique et politique féministe. En tirant le genre vers ce qu’elle a appelé la performance et la performativité qu’elle associe tout en les distinguant, elle a également ouvert un nouveau chapitre. Avec la notion de performance, mot qui dans son sens anglo-américain ordinaire désigne le théâtre ou le spectacle vivant, on retrouve l’idée de Money que le genre est un rôle, une partition apprise qui est ensuite jouée et répétée publiquement. Par certains côtés, la théorie butlerienne de la performance est redevable à l’école sociologique nord-américaine de l’interaction sociale et c’est un aspect de son œuvre et de sa genèse intellectuelle que j’ai souligné depuis un certain nombre d’années et que l’on redécouvre aujourd’hui.
ALICE : D’après ce que l’on vient d’entendre, les études de genres ont longtemps été marquées par la dichotomie genre/sexe. Et il y a eu des pensées qui sont venues percuter cette dichotomie, c’est l’effet de la rencontre d’avec la French Theory. C’est Foucault et ses rapports de pouvoir, Derrida et Cixous et leur indistinction, Lacan et ses positions inconscientes. Nous, ce que l’on avait envie de discuter avec vous pour finir, c’est l’apport de la psychanalyse dans l’articulation entre genre et sexualité, entre scène sociale et scène de l’inconscient. On a beaucoup parlé de la construction sociale, or tout n’est pas construction. Comment la psychanalyse vient-elle rajouter la scène de l’inconscient et complexifier cette articulation ? On voulait tenter de comprendre avec vous cette articulation entre psychanalyse et études de genre que vous tentez dans vos travaux, en particulier dans le contexte de Me too pour que cela soit concret.
L’outil de la psychanalyse
ANNE EMMANUELLE BERGER : Ce sont de très vastes questions, merci de les poser. C’est vrai que contrairement à Isabelle Stengers, je me sers des outils de la psychanalyse pour des raisons que je vais évoquer très rapidement. La psychanalyse a occupé un terrain et fourni des instruments d’analyse qu’il me semble important de ne pas ignorer quand on cherche à problématiser d’une manière ou d’une autre non seulement les différences de sexes et de sexualités, mais également la distinction entre sexe et genre. Pourquoi ? La psychanalyse est comme la théorie du genre. Il n’y a pas la théorie du genre. En psychanalyse, il n’y a pas la psychanalyse. Il y a eu Freud qui travaillait dans un espace bouillonnant en train de se constituer. Il y en avait d’autres moins connus, mais qui ont été importants à l’époque comme Havelock Ellis en Angleterre et bien d’autres encore. Et puis le champ de la psychanalyse ou de la pensée de la psychanalyse a tout de suite été, je vous en donnerai un exemple, un champ de discussions et de dissensions internes. Par ailleurs, « la » psychanalyse a pris des directions très différentes et s’est inscrite socialement et culturellement de manière très différente selon les espaces dans lesquels elle s’est plus ou moins implantée. Autrement dit, il n’y a pas la même histoire de la psychanalyse, ni le même discours psychanalytique, ni la même clinique, aux États-Unis, en France, en Amérique latine, etc. Pourquoi la psychanalyse ? Parce qu’elle a justement pris comme objet central les rapports indissociablement sociaux et sexuels entre hommes et femmes, pas seulement dans la relation hétérosexuelle, mais dans toute la gamme complexe des relations familiales et intergénérationnelles. Parce qu’elle a aussi entrepris de conceptualiser ou de reconceptualiser quelque chose comme la sexualité. Elle appartient d’ailleurs à cet âge de la sexualité décrit par Foucault dans L’histoire de la sexualité et dont elle constitue, en un sens, la pointe la plus avancée. Et elle a entrepris de reconceptualiser sur des bases nouvelles les différences de sexe et de sexualité à partir de modèles fondamentalement dynamiques et non pas statiques. En ce sens, elle constitue bien dès sa genèse ce que Gayle Rubin, une des premières théoriciennes du genre a appelé, dans The Traffic in Women, une « théorie féministe manquée ». Et d’abord, parce que la psychanalyse a eu affaire au genre dès ses premiers questionnements. Freud anticipe d’une certaine façon sur Simone de Beauvoir en montrant, c’est l’une de ses hypothèses, que l’on ne naît pas femme, mais qu’on le devient. L’objet de la psychanalyse, c’est tout ce qui touche à la sexualité et à la scène du désir. Et donc je veux bien essayer de dire quelque chose concernant Me too dans cette perspective. On peut dire que la pensée freudienne et celle de Lacan ne sont pas monolithiques, comme toutes les pensées fortes. On parlait hier de l’évolution de la pensée de Donna Haraway, qui surgit dans un certain contexte et qui, aujourd’hui, reformule et déplace elle-même ses propres questions. Il en va de même avec Freud, sa pensée fut une pensée en chantier. Il n’a pas cessé de revenir sur ses premières formulations, ses premiers énoncés, les remettants en question en permanence. Même Lacan qui a commencé armé du structuralisme, et qui est un bulldozer théorique, a vécu ce même questionnement. Et pas à n’importe quel moment : à partir du début des années 1970 et sous l’influence d’un certain nombre de penseuses que j’appellerai, pour le dire vite, féministes, mais qui travaillaient elles-mêmes avec les outils de la psychanalyse. Lacan n’était pas quelqu’un de sourd à ce qui se passait, intellectuellement, mais aussi culturellement et socialement, dans son environnement. Donc à partir du moment où il a été interpelé par certaines femmes engagées dans le MLF, Lacan a sérieusement infléchi ses premières propositions et a changé de formulation. Mais pour en revenir à Freud, ce qui m’intéresse chez lui, c’est qu’il propose à la fois une théorie phallocentrique et une théorie du phallocentrisme. En ce sens, et à ce double titre, il nous donne quelques instruments pour penser le phallocentrisme. Mais qu’est-ce que le phallocentrisme ? La notion n’est pas exactement synonyme de domination masculine. D’où l’importance d’avoir plusieurs cordes à son arc réflexif. Penser la domination est nécessaire, mais ce n’est pas exactement la même chose que penser le pouvoir, et penser le pouvoir n’est pas non plus la même chose que penser l’autorité. L’autorité n’est pas la domination. Le phallocentrisme, voilà encore un phénomène culturel et une catégorie analytique supplémentaire dont il faut, à mon avis, tenir compte et qui, je l’ai dit, ne relève pas exactement d’une problématique de la domination. Alors qu’est-ce que ça veut dire ? Quelques éléments d’abord sur l’invention de ce néologisme : la notion de phallocentrisme est née au sein même du champ psychanalytique dans les années 1920-1930. C’est un néologisme forgé à partir du mot « phallus » par des psychanalystes qui étaient des disciples sinon des amis de Freud, tels qu’Ernest Jones et la psychanalyste féministe anglo-américaine qui s’appelle Karen Horney. Elles et ils ont inventé la notion de phallocentrisme pour critiquer leur maître Freud, dont ils contestaient la théorie de la féminité. Pour Freud, la féminité, au sens psychanalytique du terme, a fondamentalement partie liée avec la problématique de la castration. À un certain moment, et je schématise à l’extrême, le petit garçon perçoir la fille comme castrée et la fille elle-même se reconnaît comme castrée. Mais qu’est-ce qui fait que la fille accepte ce fantasme du garçon et se voit d’une certaine comme le garçon la voit ? Qu’est-ce qui fait qu’elle assume subjectivement la vision que le garçon a d’elle ? Pour Freud en tout cas, la féminité n’est pas innée — rappelez-vous, la petite fille est d’abord « un petit homme » —, c’est une formation secondaire. Et une réaction très complexe à un contexte social et culturel dont Freud soupçonne, sans toutefois développer la question, qu’il influe sur la façon dont on socialise les enfants traditionnellement. Au début, la figure maternelle est toute-puissante pour le petit enfant. Et puis à un certain moment, dans une société que structure la division entre sphère domestique et sphère publique, il faut passer dans le monde et donc sortir de la maison des femmes pour entrer dans le monde des hommes. Il faut alors se séparer de la mère. Celle-ci se voit donc dévalorisée, et cette dévalorisation prend la forme imaginaire et symbolique d’une castration. Il y a eu une énorme dispute au sein du champ psychanalytique qui a duré 10 ans et qui a tourné autour de ces questions. Est-ce que la féminité au sens psychanalytique du terme est une formation primaire ou secondaire ? Pour Freud, c’est une formation secondaire et réactive. C’est justement la conséquence ou la forme que prend l’entrée dans le paradigme de la castration. La féminité, au sens psychanalytique du terme, a à voir avec ce que Freud appelle l’envie du pénis, envie qui consacre ce que Lacan nomme le primat du phallus, pour les « femmes » comme pour les « hommes ». Plus précisément, l’envie du pénis résulterait du fait que la fille se sentirait lésée, castrée, et se verrait comme elle est vue, manquante, en défaut. Elle n’aurait alors de cesse de convoiter le pénis ou son substitut symbolique, voire de prétendre être ce qu’elle n’a pas (le phallus) pour se rendre désirable par l’homme. Ce serait cela, la situation ou la position « féminine ». Elle consacrerait la centralité du phallus pour les femmes, comme pour les hommes qui craignent, pour eux aussi, la castration. Ainsi la notion de phallocentrisme est-elle née au sein même du champ psychanalytique. C’était un petit missile envoyé dans la direction de Freud, pour le contester de l’intérieur, par des psychanalystes qui ne croyaient pas que la question de la castration, donc de la possession ou non du pénis et de la convoitise qu’il suscite, soit déterminante pour le développement de la féminité. Pourquoi cette notion me parait-elle intéressante et en quoi ne recoupe-t-elle pas entièrement la question de la domination ? Dans le paradigme de la domination, c’est simple, si j’ose dire : il y a des dominants et des dominé.e.s. Mais avec le phallocentrisme, on est invité.e à penser la complicité des femmes dans l’établissement et le maintien d’un ordre sexuel. Selon Freud, et selon Lacan, ce ne sont pas seulement les hommes, mais aussi les femmes (en tant qu’elles adoptent une position « féminine ») qui sont fixé.e.s sur le phallus, lequel ne désigne pas l’organe génital masculin, mais ce que celui-ci symbolise : un pouvoir qui suscite et alimente, comme tel, le désir.
L’affaire #metoo
On arrive dans les parages des questions posées par la scène qui a déclenché la révolte Me too, soit une scène dans laquelle les femmes n’ont pas été « simplement » victimes d’attouchements, voire de viol, mais une scène à laquelle quelque chose en elles a accepté de participer, d’où le fait que la dénonciation a lieu longtemps après les faits. La complicité des femmes dans cette affaire n’est bien sûr pas une complicité individuelle, ni une faute morale. C’est une complicité générée par ce que l’on pourrait appeler la clôture phallocentrique, tel que les femmes sont prises dans une scène de désir commandée le primat (symbolique, culturel, social, donc aussi psychique) du phallus. On le sait, ce n’est pas parce que l’on est femme ou s’identifie comme telle que l’on n’est pas misogyne. D’où les difficultés que nous avons à aborder la scène du désir et celle de la sexualité, beaucoup plus compliquées à traiter que, par exemple, les questions d’inégalité dans le monde du travail. Hier, Isabelle Stengers évoquait un slogan du MLF qui a été très important : « le personnel est politique ». Or, dire que le personnel est politique, ce n’est pas la même chose que de dire : « le domestique est politique ». Quand on dit que « le domestique est politique », ce sur quoi on met l’accent, c’est sur la division des tâches entre sphère domestique et sphère publique, donc sur la division sexuelle du travail. Mais si on dit « le personnel est politique », avec la notion de « personnel », on fait entrer tout ce qui touche au registre de l’intime, et donc la question de la sexualité et du désir. Qu’est-ce qu’a révélé l’affaire Me too ? Il y aurait plein de choses à dire sur le fait que ce mouvement est parti de Hollywood, qui n’est pas n’importe quelle scène d’interaction sociale. Le fait que la scène primitive de Me too mette aux prises des actrices ou des aspirantes-actrices et des producteurs me parait fondamental : une actrice, en tout cas dans le système hollywoodien traditionnel, doit se conformer au rôle de la femme comme objet de désir. Elle se doit d’adopter cette position. Cinématographiquement, de toute façon, elle est constituée comme telle. Et donc elle doit assumer subjectivement cette position d’objet. Qu’est-ce que révèle l’histoire de Me too ? Elle révèle d’abord le caractère massif de l’expérience vécue par les actrices et témoigne de la formidable force de frappe des réseaux sociaux. Les expériences ainsi mises au jour, admises, racontées, concernent malheureusement, il faut le dire, la presque totalité des femmes à un moment de leur vie. Que ce soit dans l’enfance, à l’adolescence ou à l’âge adulte. Ce sont des expériences qui vont du harcèlement de rue jusqu’au viol en passant par toutes les gradations, toutes les gammes d’attouchements si l’on peut dire. Mais ce qui m’intéresse dans cette scène en particulier, c’est que c’est une scène différée. Dans un premier temps, et pendant longtemps, ces femmes n’ont rien dit. Pourquoi ? Dans un premier temps, ces actrices ou aspirantes-actrices ont donc « consenti ». Mais attention ; comme vous le savez, il y a un abîme entre dire « je veux bien » et dire « je veux ». Ça n’a rien à voir. « Je veux », c’est la formule du sujet désirant, qu’il ou elle soit femme ou homme. Si on dit « je veux bien », cela veut justement dire que l’on ne veut pas vraiment, qu’en fait, on ne veut pas. Quand il s’agit de scène du désir, justement on veut l’autre. L’autre sujet. Alors certes, on peut se tromper sur cette personne, — c’est d’ailleurs généralement le cas, on ne connaît pas la vérité ou la réalité de l’autre, peut-être parce qu’il n’y en a pas — mais cette méprise est structurelle, ce n’est pas une faute ou une erreur. En tout cas, même si l’autre, bien sûr, est l’objet de mon désir , c’est un objet que je reconnais et à qui je reconnais sa position de sujet. Quand on consent, on ne consent pas à l’autre, on consent à quelque chose. On veut un « qui », mais on consent à un « quoi ». Ce n’est pas du tout la même scène. Donc qu’est-ce qui se passe dans cette scène révélée par Me too ? C’est d’une banalité extrême et en même temps d’une complication extrême. La même chose se passe dans la sphère de l’université aux États-Unis (et peut-être aussi en France, mais on en parle moins). Beaucoup d’histoires ont lieu entre étudiantes et profs sur un fond de dissymétrie statutaire. Un prof peut courir après une étudiante dont l’admiration flatte son ego et rassure sa virilité. Mais il (ou dans certains cas elle) peut aussi susciter une forme de désir, qu’alimente et encourage le transfert dont il ou elle fait l’objet en tant que détenteur d’un savoir/pouvoir. Une personne en position de pouvoir (position qui a cependant peu à voir avec la nature et le degré réels du pouvoir qu’on lui prête) exerce un attrait et suscite une forme de désir que la psychanalyse identifie comme un « désir du phallus ». Toutes les histoires de ce type qui font l’objet d’une poursuite judiciaire ont la même structure : il y a d’abord un rapport « consenti », et ensuite quelque chose (qui est en rapport avec le réveil des consciences, les luttes féministes, etc.) fait que l’on se réveille, que l’on revient sur cette histoire et que l’on se dit que c’est insupportable. Cela témoigne d’une division originelle, si l’on peut dire, de la personne, en l’occurrence des femmes, dans cette scène-là. Comme je vous le disais tout à l’heure, « je veux bien », ce n’est pas « je veux ». Quand je dis « je veux », j’y vais de tout mon corps et de toute mon âme. Si je dis « je veux bien », c’est que je ne veux pas. Et ce « je ne veux pas » finit par faire retour, quand une occasion lui en est donnée. D’une certaine façon, c’est ce qui s’est produit avec la scène de Me too. Pour penser la complication de cette scène de « désir », il faudrait aussi distinguer entre pulsion et désir. Pulsion n’a rien à voir avec instinct. Je vous disais tout à l’heure que, quand on veut quelqu’un, on veut un « qui ». Quel que soit d’ailleurs son genre ou son identité. Là, je parlais du point de vue des femmes. Mais si j’imagine le point de vue de Weinstein, de Strauss-Kahn et autres, il est évident que dans les passages à l’acte, agressifs, violents, il n’y a pas, en face d’eux, de sujets. C’est de la pulsion sans objet qui se satisfait. L’autre n’existe pas. C’est pour cela que, non seulement il s’agit d’une violence physique, mais aussi d’une violence symbolique extraordinaire. En l’occurrence ici, les autres auxquels les violeurs ont à faire sont des trous dans lesquels s’abîme et se satisfait la pulsion. Il faut donc distinguer entre passage à l’acte pulsionnel et désir. Or tout ça, ce sont des questions que la psychanalyse, qui utilise un vocabulaire précis pour tenter de distinguer pulsion et désir par exemple, ou encore de penser ce que c’est qu’un objet de désir, peut permettre d’aider à penser. La psychanalyse fournit des outils à cet égard-là. Voilà pourquoi je pense, contrairement à certains et certaines, que c’est dommage de s’en priver. Qu’en tous les cas, même s’il faut critiquer certains de ses attendus et certain.e.s de ses praticien.ne.s, il faut la lire.
Du consentement
GABRIELLE : Je m’interroge sur ce que vous dites par rapport au « on veut un qui » qui serait la position masculine, disons dans ces affaires récentes, et où la femme occuperait la position du « on consent à quelque chose », en tous les cas dans un premier moment jusqu’à ce qu’il y ait un retour en arrière en disant finalement : « je ne voulais pas ». J’ai l’impression que, si je repense à quelques-uns des articles que j’ai pu lire sur ces différentes affaires et notamment sur l’affaire Tariq Ramadan, j’ai l’impression que c’est plus complexe que ça. C’est-à-dire que la justice a fait sortir de manière horrible et difficile des textos, des mails, etc. Et dans ces textos, il n’y a pas que des « je veux bien », mais véritablement des « je veux ». C’est ce que j’ai pu comprendre de mes lectures et c’est ce qui me perturbe beaucoup. De vraiment pouvoir passer d’un « je veux » à un « en fait, je ne voulais pas ». J’ai l’impression qu’il y a quelque chose qui se joue dans la signification d’avoir voulu. Une sorte de retour sur soi : à quel endroit est-ce que je me suis mise, au moment où j’ai voulu et qu’est-ce que ça signifie de moi ? C’est une sorte de retour réflexif. Qu’est-ce que ça signifie socialement pour moi d’avoir voulu avec lui ? Qui en fait est une sorte d’image de soi qui devient intolérable.
ANNE EMMANUELLE BERGER : Dans l’affaire Tariq Ramadan, autant que l’on puisse la comprendre à travers la presse, je dirai que ça pousse très loin, au fond les apories, les difficultés, les impasses et les complications auxquelles je faisais allusion à l’instant. Mais que c’est quand même du même ordre. Ce type horrible est un prédateur comme on dit. Et donc qu’est-ce qu’il fait ? Il cherche des proies et il en trouve facilement à partir de sa position de pouvoir. Il cumule la position de l’autorité professorale et la position d’un chef religieux et quasi-politique, il est celui qui transmet la vraie parole dans un contexte qui est aussi un contexte d’adhésion dogmatique. Quand je dis dogmatique, peu m’importe de quel dogme il s’agit, c’est un constat. On adhère à une pensée commune, une religion commune, quelle qu’elle soit. Donc, il y a déjà ce fond-là. Il est en position de pouvoirs multiples. Et puis, il fond sur des proies qu’il constitue ou fait semblant de traiter en objet du désir. Le problème des femmes en régime hétérosexuel classique, c’est que, comme je le disais plus haut, — et c’est pour cela que le système a perduré si longtemps — dans la mesure où, pour être valorisée comme femme dans un monde d’hommes (ou disons dans un monde dans lequel les femmes jusqu’à très récemment ont été des objets d’échanges et de convoitise), pour être valorisée comme femme, donc, et pour se valoriser comme femme aussi, il faut qu’elles adoptent elles-mêmes subjectivement la position d’objet de désir. Les voilà constituées de manière très brutale comme objet de désir. C’est très difficile pour ces femmes qui ne sont pas des féministes, qui manquent de ressources critiques et réflexives, et qui peut-être aussi ont une vie sexuelle assez pauvre, parce qu’en partie interdite, de résister à l’interpellation, à leur apparente élection. Donc elles sont séduites, littéralement, par la séduction qu’elles croient exercer sur celui qui leur dit « je te veux ». Et dès lors elles sont accrochées. C’est ça le phallocentrisme. C’est-à-dire qu’elles sont aimantées ou attirées d’elles-mêmes, de leur propre chef en apparence. Sauf que, bien sûr, ce type est une ordure. La scène telle qu’elles la racontent s’avère d’une violence extrême et donc on peut imaginer que, alors même qu’elles étaient accrochées, hameçonnées, et que leur élection par ce chef charismatique avait suscité chez elles une réponse désirante, une réponse amoureuse jusqu’à un certain point, il y a eu un moment où le désagrément, sinon le désagrégement subjectif, l’a emporté sur le bénéfice de se conformer à la position classique d’objet de désir, supportable, peut-être même agréable, lorsqu’on vous reconnait aussi une place ou une fonction de sujet. À un certain moment , c’est devenu insupportable pour ces femmes. Je ne sais plus si les premières dénonciations datent d’avant Me too ou non.
GABRIELLE : Oui.
ANNE EMMANUELLE BERGER : Ça a dû être extrêmement difficile. D’autant plus dans un contexte où se tient un discours de nécessaire soumission des femmes. Il leur a fallu, à mon avis, beaucoup de courage. C’est un parcours long et difficile pour parvenir à penser leur situation. Et donc, à un moment, de pouvoir dire « stop c’est insupportable », c’est-à-dire de reconnaître que le bénéfice classiquement tiré de l’adoption de la position d’objet de désir et de la recherche même de cette position peut s’effacer devant le dommage psychique subi.
GABRIELLE : Mais du coup, le bénéfice ne peut être calculé qu’après, d’une certaine façon. Ce qui déplace complètement la question par rapport au consentement. Ou en tout cas, le consentement ne permet plus de se poser cette question-là. C’est-à-dire que si je dis tout à fait « oui » au moment où il y a un acte sexuel et qu’ensuite je fais un calcul pour voir si en fait...
ANNE EMMANUELLE BERGER : Ce n’est pas un calcul conscient.
GABRIELLE : Oui bien sûr. Mais si c’est dans un second temps que je peux évaluer dans quelle mesure est-ce qu’être objet du désir était quelque chose qui m’a plu, qui subjectivement me convient ou ne me convient pas, ce n’est plus la question de savoir si j’ai consenti.
ANNE EMMANUELLE BERGER : Si je comprends bien ce que vous êtes en train de dire, et j’en serais assez d’accord, c’est que la problématique du consentement n’est pas suffisante. On parle beaucoup aujourd’hui de la nécessité du consentement, y compris sous une forme contractuelle a priori, etc. Je pense comme vous que ce n’est pas suffisant pour penser la complexité de ces scènes-là.
Bibliographie non-exhaustive :
BERGER Anne Emmanuelle, Le Grand théâtre du genre (2013)
BUTLER Judith, Trouble dans le genre (1990)
DE BEAUVOIR Simone, Le Deuxième Sexe (1949)
DE LAURETIS Teresa, Théories queer et cultures populaires (2007)
FOUCAULT Michel, Histoire de la sexualité vol.1 (1976)
FREUD Sigmund, Trois essais sur la théorie sexuelle (1905)
GOFFMAN Erving, La mise en scène de la vie quotidienne (1956)
KOSOFSKY SEDGWICK Eve, Epistémologie du placard (1990)
RUBIN Gayle, The Traffic in women (1975)
SCOTT Joan, Le genre, une catégorie utile de l’analyse historique (1986)
mais aussi Kimberlé Crenshaw dont les ouvrages ne sont pas traduits...
28 octobre 2021
« On a l’impression de pouvoir porter tous les pronoms, et en même temps de n’en tolérer aucun. » - par Club de Bridge
« Se laver, c’est s’absenter à son propre corps »
28 Novembre 2020
« Il est fondamental que le sujet prenne le temps de dénouer les fils de sa jouissance. »
28 Mars 2020
« Ce qui inquiète c’est donc d’abord le caractère « sans essence » du féminin et du masculin que décrit la psychanalyse mais c’est aussi, et surtout, la possibilité que le féminin l’emporte sur le masculin. »
Réponse à « Wittig avec Cixous »
28 Décembre 2020
Dernier épisode de la série Ces hommes qui voulaient faire fumer les femmes. Il raconte l’incroyable propagande qui fut menée par l’industrie du tabac pour raccorder le désir d’émancipation féministe et la cigarette.