Ce texte se propose de lire ensemble deux livres récents des études et des activismes handis : une autobiographie militante de la philosophe Charlotte Puiseux (De chair et de fer. Vivre et lutter dans une société validiste, Paris, La Découverte, 2022) et un recueil de « prophéties, mots d’amours et chants de deuil » de la poétesse et militante crip Leah Lakshmi Piepzna-Samarasinha (The Future Is Disabled. Prophecies, Love Notes, Mourning Songs, Vancouver, Arsenal Pulp Press, 2022). Un appel à affiner les alliances trans/crip et neuroqueer, et à apprendre les leçons dévalideuses de la vie qui insiste dans les ruines du capitalisme extractiviste.
Image en couverture : Marguerite Maréchal, Corset Colonne, 2022.
Version audio : https://soundcloud.com/loeil-et-la-main/recits-crip-pour-des-futurs
Le mot crip (de l’anglais cripple : éclopé·e, infirme, estropié·e) partage avec le mot queer (du moyen bas allemand qver ou queer : oblique, de travers, tordu·e) l’image du pas-droit. Tous deux sont des mots-stigmates désignant des manières d’habiter l’espace et le temps qui résistent à l’évidence des flux, qui se désalignent et prennent des chemins de traverse. Des désirs queer : des désirs qui s’orientent vers les mauvaises sortes de corps – pas du bon genre, pas du bon nombre, pas de la bonne couleur de peau, pas la bonne partie du corps investie. Des corps crip : des corps qui ne vont pas aux bons rythmes – des corps qui roulent, des corps qui stimment, des corps qui ont des tocs, des corps trop ou pas assez sensibles à certains stimuli.
Que se passe-t-il quand on commence à faire de cette désorientation un cri de guerre ? Quand on refuse le redressement ?
L’activisme queer est célèbre pour avoir été un lieu où le stigmate de la dés/orientation sexuelle s’est retourné en terrorisme de genre : « Not GAY as in Happy, but QUEER as in Fuck You ! », clamait Queer Nation dans les années 1990. Vingt ans plus tôt, bien avant que les cris de guerre de la nation cuir ne fassent sursauter les empâtements homonationalistes de l’in-té-gra-tion des soupes alphabétiques (LGBTQQIA2S+), des collectifs handiactivistes développaient des slogans qui refusaient l’assignation au modèle de la « bon·ne malade ». En France, ielles se sont revendiqué·es Handicapés Méchants, se figurant comme des saboteureuses en fauteuil de la bonne marche (sic !) du capitalisme mondial intégré et de sa charité envers les invalides :
« LA CHARITÉ NOUS ASSUJETTIT À LA MISÈRE PHYSIQUE _ INTELLECTUELLE ! […] HANDICAPES ET VALIDES, REFUSEZ DE DONNER ET PARTICIPEZ A LA MANIFESTATION CONTRE LA QUÊTE NATIONALE [1] ! »
Héritière, cinquante ans plus tard, de ces vénérables ancêtres handianarchistes, la philosophe Charlotte Puiseux propose avec De chair et de fer une autothéorie militante de sa lutte contre le validisme [2].
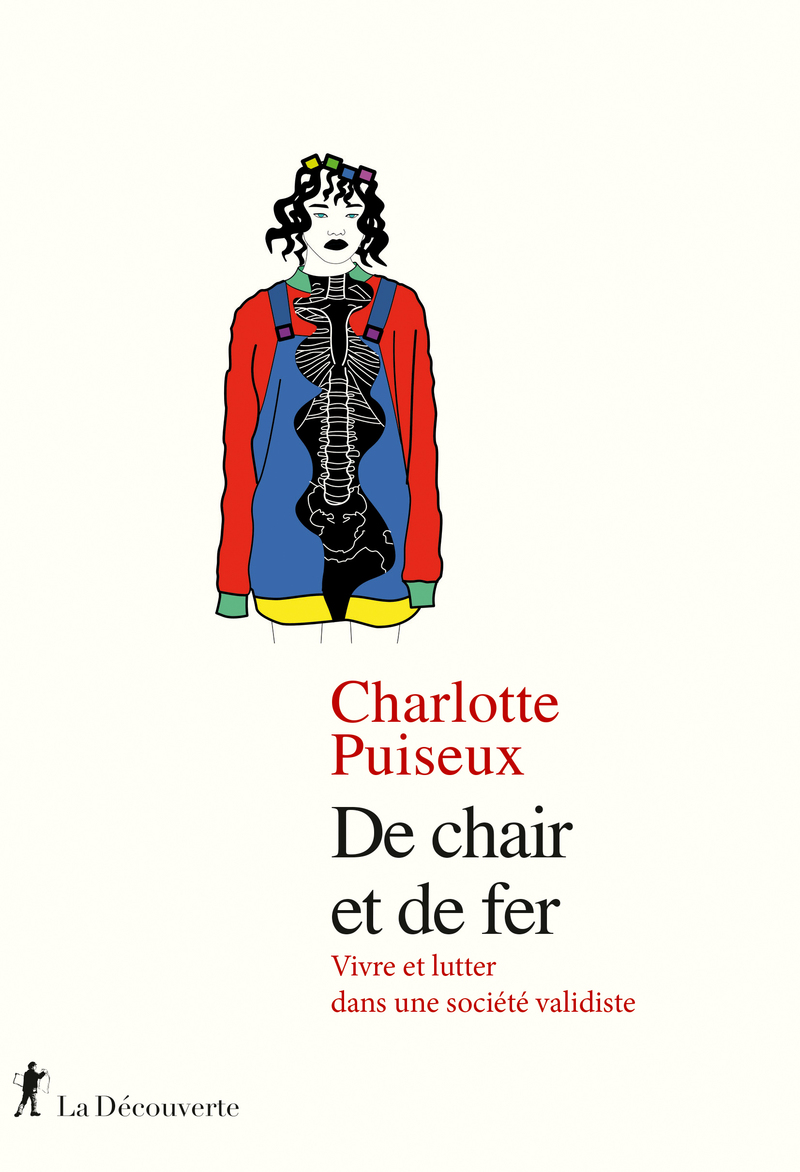
Autrice, déjà, d’un Dictionnaire crip et d’un certain nombre d’articles sur les études handies, Puiseux livre avec De chair et de fer une sorte de roman d’apprentissage activiste où elle nous fait traverser ses tentatives multiples pour trouver où et comment mener une lutte à l’intersection du marxisme, du féminisme, et du handiactivisme.
Plus exactement, le texte se présente comme une traversée des échecs (et dans une moindre mesure des réussites) à trouver des formes d’alliances ajustées entre ces différentes échelles de lutte, traversée qui permet à Puiseux de montrer les continuités du validisme, du Téléthon – et de la vision médicale-caritative du handicap à laquelle il contribue, et des malaises que cela suscite en elle dès l’enfance –, jusqu’au Nouveau Partie Anticapitaliste (NPA) – et de l’oubli des situations handies, voire de la peur d’y être associées, qu’elle y rencontre. Puiseux donne ainsi l’exemple d’un épisode où, faisant face à la réduction du nombre de militant·es, elle propose aux commissions LGBT+ et Handicap du NPA de fusionner : la suggestion est « très mal reçue […]. Il était inenvisageable d’opérer un tel rapprochement, car il associerait les identités lgbt+ à des handicaps […], il fallait fuir absolument cette identité pestiférée qui ne pouvait en aucun cas s’inscrire dans un processus de revalorisation tel que les identités lgbt+ l’avaient justement connu. » (p. 133-134)
Ce que ce parcours de tentatives intersectionnelles permet à Charlotte Puiseux de manifester, c’est la persistance d’idéaux normatifs à l’intérieur des espaces militants, et l’opportunité à ce titre que peut représenter le handicap de ne pas oublier la violence de cet ordre normatif :
« La normalité est un idéal inaccessible qui maintient béante une faille identificatoire, car personne ne peut jamais être complètement normal. Les militantes handicapées, en revendiquant leur impossibilité à atteindre cette normalité, proposent d’imaginer de nouvelles configurations sociales, une nouvelle sphère publique, de nouveaux liens sociaux, qui ne feraient pas reposer la participation à la vie sociale sur les capacités. » (p. 130)
C’est notamment avec Les Dévalideuses, une collective handiféministe fondée en 2019, que Puiseux commence à trouver un réseau qui revendique le désordre social provoqué par le handicap, plutôt que de se contenter de réclamer l’inclusion dans l’ordre valide. Comme le suggère la philosophe féministe Sara Ahmed dans On Being Included, il est urgent de se désinoculer du désir d’inclusion : bien trop souvent, vouloir être inclus·es revient à vouloir être toléré·es (l’inclusion comme bienveillance des gens tolérants) ou absorbé·es (l’inclusion comme conversion à la normalité) par l’hégémonie. Sans doute, il est justifié de vouloir la non-exclusion, sans doute il est justifié de refuser d’être mis·es à la porte, ou de ne même pas pouvoir y accéder faute d’ascenseur. Mais cela ne veut pas dire qu’il faudrait pour cela vouloir être inclus·es, c’est-à-dire « validé·es » par les systèmes mêmes qui nous oppriment.
Dévalider, dans ce cadre crip de refus critique de l’inclusion signifie donc : refuser la validation du validisme, et, plus avant, questionner le monde qui le rend possible.
Dévalider, c’est ainsi en premier lieu, refuser le capitalisme extractiviste et son humanisme, qui définissent l’humain uniquement par sa capacité à contribuer à l’effort de production, et qui partent à la chasse de tout ce qui se présente comme déficient par rapport à une norme d’efficacité impossible à tenir, et où les personnes handicapées servent de modèles-repoussoirs des mauvaises travailleureuses.
Dévalider le capitalisme extractiviste, cela veut donc inséparablement dire lutter contre toutes les formes de définitions des minorités comme des humains déficients – des handicapé·es, donc, mais aussi : des femmes, des queers, des « autres » racialisé·es. On ne sera pas surprises de ce point de vue de savoir que la première définition du mot ableism (qu’en France on traduit en « validisme » et qu’au canada on traduit en « capacitisme ») est donnée non seulement dans une revue féministe (Off Our Backs, vol. 11.5, 1986) mais plus précisément dans une « Lettre ouverte aux lesbiennes handicapées » : « le validisme est l’oppression systémique d’un groupe de personnes justifiées par la référence à ce que celles-ci peuvent faire ou non avec leur corps ou leur esprit [3] ». La traduction française du terme, de même, vient d’un militant queer handi, Zig Blanquer, dans un zine satirique sur La culture du valide (occidental). Ou comment le validisme ça te concerne sûrement, paru en 2004 [4]. Une attestation, s’il en fallait, du caractère nativement intersectionnel (même si l’intersection reste longtemps contenue par la blanchité) des luttes dévalidistes.
Plus récemment, l’activiste crip et abolitionniste carcérale Talila A. Lewis donnait une définition du validisme qui en étend les implications aux dimensions raciales et coloniales, dépendantes d’un paradigme humanoexceptionnaliste :
« Le validisme est un système d’assignation des corps et des esprits, fondé sur les idées socialement construites de normalité, de productivité, d’intelligence, d’excellence et d’adaptation. Les idéaux validistes sont profondément enracinés dans l’eugénisme, l’anti-Noirceur, la misogynie, le colonialisme, l’impérialisme et le capitalisme. […] Il n’est pas nécessaire d’être handicapé·e pour faire l’expérience du validisme [5]. »
Contre toute tentation de faire des luttes handies des luttes qu’on pourrait contenir aux « personnes en situation de handicap », luttes auxquelles les valides ne pourraient se joindre au mieux que par solidarité, au pire que par charité, le livre de Puiseux – comme cette définition du validisme par Talila Lewis – nous rappelle que le validisme est un système d’oppression qui pèse sur toustes, même s’il menace davantage la vie de celleux d’entre nous qui passent le moins (et/ou se refusent le plus à passer) pour valides.
Mais dévalider, c’est aussi, plus spécifiquement, refuser le biopouvoir et le pouvoir médical d’État qui définissent leur fonction comme une fonction de sauvegarde et de régulation des corps sains, et de relégation ou de rectification des corps malades. C’est refuser l’approche médicalisée du handicap qui ne pourvoit, comme avenirs possibles pour les personnes handicapées, que la guérison de leur « invalidité/incapacité » (à marcher, à entendre, à parler), où l’image de la réussite est représentée par l’athlète handisportive, héroïne d’une saga individualiste où la personne handicapée n’est humanisée qu’à raison de sa capacité à « inspirer » – selon la logique de la « pornographie inspirationnelle », une sorte de « validisme prétendument bienveillant » qui « se présente comme un intérêt à l’égard des personnes handicapées, voire un amour pour ces personnes censément frappées par un destin tragique » mais qui ne fait que les définir comme autre-qu’humaines et les considérer comme anormales (p. 30).
Il y a donc une continuité entre la déficience et l’héroïsme impliqués dans le paradigme du biopouvoir : c’est celle de considérer le handicap comme une affaire individuelle, comme quelque chose que porterait la personne handicapée (ou pire : comme une affaire de volonté, où les quelques athlètes « héro·ïnes » servent de preuve que les autres, les « mauvais·es handicapé·es » n’y ont pas mis suffisamment du leur). Dévalider le biopouvoir, c’est donc lutter contre l’individualisme structurellement attaché au validisme, et comprendre le handicap comme un fait collectif, la résultante de valeurs accordées à certaines vies plutôt qu’à d’autres.
D’un point de vue matérialiste-concret, dévalider le biopouvoir, c’est donc poser la question de l’accessibilité, c’est-à-dire de qui est considéré comme un membre à part entière de l’espace public (peut-on, ou pas, s’y rendre ?). C’est la question des transports en communs accessibles, des rampes d’accès, des ascenseurs ; mais c’est aussi la question des toilettes accessibles et de leur répartition (question par où les handiactivismes rejoignent les transactivismes qui eux aussi, doivent se battre pour permettre aux personnes trans* d’utiliser les lieux d’aisance qui leur conviennent). Et c’est encore la question de la présence des personnes en fauteuil en manif (question qui rejoint par exemple, celle de la « présence problématique » de certaines personnes dans les mouvements et les actions directes : les vieux, les vieilles, les Fol·les, et, dans un autre sens encore, en ce qui concerne les prides bien lissées de la fierté gay : la « présence problématique » des TDS, des exubérantEs, des pédales, des trans*cuir...). Comme tout à l’heure, on voit ici comment la perception médicalisée de certains corps les proscrit du politique et comme tout à l’heure, il y a de la puissance à les faire insister dans l’espace public.
Dévalider, c’est encore refuser la sexualité normative qui « relègue les êtres handicapés dans le non-désirable, le non-sexualisable, le ni beau ni moche, le juste invisible » (p. 40). C’est là un des endroits où d’évidence, la rencontre avec les activismes et les théories queers se fait, notamment parce qu’il est alors question des carcans de la sexualité obligatoire et de la régulation des orientations envers les objets du désir – un bon objet du désir étant : un corps jeune, sain, capable de contribuer à l’utéroreproduction de la nation/de la race, manifestant un genre clairement attribuable et appartenant à « l’autre sexe ».
Puiseux renvoie ainsi à la militante canadienne handie crip et actrice de films pornographiques Loree Erickson :
« Les personnes handies […] n’avons jamais cessé de créer et de trouver des lieux où nous sommes apprécié·es et célébré·es pour les différences mêmes qui justifient notre oppression. […] Je trouve de la force dans cela même qui est perçu comme un site de honte : la dépendance, la vulnérabilité, et le fait d’être un corps du « dehors », un corps perturbateur. Autant de ressources pour la libération sexuelle et corporelle potentiellement utilisables par tous les corps [6]. »
C’est un leitmotiv dans tout l’ouvrage que cette considération accordée aux sexualités crip, au refus de la désexualisation des personnes handies (ou de leur fétichisation, ce qui revient au même). La question sexuelle réapparaît ainsi à plusieurs reprises comme une des pierres d’achoppement des alliances et de l’intersectionnalité handiactivisme/féminisme notamment : d’un côté, la question de l’hypersexualisation du corps des femmes, centrale dans certains aspects du féminisme, entre en conflit avec l’expérience d’être femme et handicapée, c’est-à-dire bien souvent « exclue du marché de la bonne meuf » (dixit Despentes, citée p. 39) ; de l’autre, les positions anti-travail du sexe de certains handiactivismes – notamment au CLHEE, où Puiseux commence à militer, et dont l’opposition à l’« assistance sexuelle » des personnes handicapées se confond avec une opposition au « travail sexuel » en général, ce qui finit par l’en éloigner.
Puiseux occupe, à l’égard de l’assistance sexuelle, une position qu’elle déclare handiféministe : « Ce qui me gênait, ce n’était absolument pas de recourir à une forme de travail du sexe, mais c’était encore une fois le regard posé sur les corps handicapés. Ce qui me dérangeait, c’était cet exceptionnalisme moral accordé aux personnes handicapées qui pouvaient ainsi recourir à une forme de prostitution sans être socialement dénigrées. Les travailleuses du sexe s’adressant spécifiquement à cette population devenaient même soudainement des bienfaitrices, alors que leurs collègues travaillant avec des valides restaient condamnées à l’opprobre social. » (p. 123) C’est cette position qui fait que Puiseux se tourne notamment vers le Strass (le Syndicat du Travail Sexuel), où elle trouve un espace d’alliées précieuses, notamment parce que s’y interrogent les « arguments victimaires qui présentent les travailleuses du sexe comme subissant leur condition » (p. 122), une rhétorique de l’incapacité, ou de la minorisation qui est bien souvent à l’œuvre à l’endroit des personnes handies. Comme à de nombreux moments du livre, c’est ce genre de circulations des logiques validistes, ce genre de points d’alliances, qui permettent de sentir combien le geste de dévalider ne concerne pas seulement les personnes qu’on dit handicapées, mais bien sûr l’ensemble des personnes qui vivent sous l’emprise du validisme.
Dévalider c’est enfin (c’est sur cela que se conclut le livre) lutter contre la repronormativité et pour l’invention de nouvelles parentalités. Par son expérience de maman handie, mais aussi au travers de ses participations au festival militant Very Bad Mother (un festival dont le slogan est « toustes les enfants sont des bâtard·es ! »), Puiseux pense la nécessité de « briser les liens établis entre le bonheur des enfants et le fait qu’elles grandissent dans une famille nucléaire, hétérosexuelle, blanche, riche et valide » (p. 144). « Parce que la société nous force à avoir des gosses, et nous dit comment », il s’agit d’imaginer d’autres manières de faire des parentés, une lutte comme dans les activismes queer et trans qui se retrouve à s’affronter aux stérilisations forcées, aux violences gynéco-obstétriques du corps médical et au familialisme du code fiscal.
De chair et de fer est un jalon important dans le déploiement des études handiféministes et des études crip en langue française, aux côtés des travaux en géographie d’Enka Blanchard, ou encore de l’artivisme de la performeuse No Anger, des analyses de la curatrice et théoricienne de l’art Sarah Heussaff ou des écrits sensuels et ciselés de Zig Blanquer. Par sa clarté et la simplicité de sa structure linéaire autobiographique, le livre articule avec rigueur la manière dont le validisme fonctionne comme un opérateur-clef des binarismes (femme/homme, nature/culture, trans/cis, queer/straight, animale/humaine…) sur lesquels se fonde l’extractivisme moderne/colonial. Un appel a une alliance intersectionnelle contre toutes les logiques qui prétendent à la (sur)validité de certain·es d’entre nous, au détriment des autres.
***
Pendant ce temps-là, au Canada, paraît The Future Is Disabled. Prophecies, Love Notes and Mourning Songs [« Le futur est handi » ou « Le futur est dévalidé. Prophéties, mots d’amour et chants de deuil »] de læ militant·e, éducateurice et poétesse Leah Lakshmi Piepzna-Samarasinha. Iel est l’auteurice du très essentiel Care Work. Dreaming Disability Justice [« Le travail de prendre soin. Rêver la justice handie »], un livre qui parlait déjà en 2018 avec force des réseaux d’entraide handie, du travail de soin perpétuel qui s’y réalise, de l’épuisement militant qui en ressort, et des nécessités de penser des « futurs dévalidés » (disabled futures), c’est-à-dire des formes de temporalités qui ne soient pas centrées sur l’efficacité, le progrès, le rendement, l’accomplissement des tâches en un temps record, et qui se posent des questions des liens qui libèrent quand ils nous lient à nos proches [7].

Avec Le futur est dévalidé, Piepzna-Samarasinha traverse les temps du coronavalidisme, et s’efforce de tirer les leçons de ce qu’ielle désigne comme un « événement de dévalidation de masse », événement aux conséquences bifides pour les visibilités handies. D’un côté, la pandémie de Covid-19 est en effet un moment où « le monde a été estropié » (the world has been cripped), chacun·e étant conduite à porter des masques, se désinfecter, limiter ses déplacements et ses contacts, prendre soin de ses proches et demander de l’aide. Mais de l’autre, Covidia International est aussi un moment où le caractère jetable des vies handies n’a jamais été aussi tristement palpable, un moment où les autorités publiques du monde (se prétendant rassurantes) peuvent tranquillement déclarer : « tout va bien, seules les personnes avec des comorbidités meurent », entendez : « tout va bien [pour la société valide], seules les personnes [handies] meurent » [8].
Piepzna-Samarasinha pense et lutte à l’intersection des luttes antivalidistes, féministes, antiracistes et écologiques, une intersection qui est de plus en plus sensible aux yeux du grand public du fait de la superposition médiatique des injustices médicales, des violences policières et des catastrophes climatiques. Face à ces réalités dont les images se mélangent sur les écrans du monde, ielle propose de développer des pratiques d’amour et de deuil au milieu des effondrements, d’un « point de vie »/point de vue à l’intersection des expériences crip et femme-of-color.
« Que se passe-t-il quand nous, les marges handies (pour paraphraser la magnifique et regrettée bell hooks) passons au centre ? Quand les normes multiples remplacent la norme unique ? Que serait ce monde si nous réussissions à le renverser de telle sorte que nul·le ne soit plus soumis·e à l’eugénisme, aux présupposés valides de ce que devrait être la normalité, l’intelligence, la productivité, la désirabilité […] ? Parce que, comme le dit Talila Lewis, “il n’y a pas besoin d’être handi·e pour faire l’expérience du validisme” : le validisme contraint et réduit l’expérience de chacun·e d’entre nous ; il nous apprend à avoir honte quand nous avons besoin d’aide, il nous inocule des idées limitées de ce qu’est l’intelligence, la valeur et de qui a droit à une famille. Je pense ici avec Toni Morrison : “Je me tenais à la frontière, sur le bord. Et ce bord, j’en fis mon centre. J’en fis mon centre, et je laissai le reste du monde se déplacer pour me rejoindre.” Quelle sorte de monde pourrions-nous faire alors ? Quels sont les mondes que nous faisons déjà ? » (p. 27-28)
L’introduction du livre (« Writing a Disabled Future ») montre que s’il est nécessaire d’imaginer des futurs dévalidés, c’est qu’une capture majeure des vies handies par le validisme consiste à en faire des synonymes d’une absence d’avenir. Comme Lee Edelman le faisait remarquer à l’égard de la perception hétérosexiste des enfants queer par leurs parents [9], les normes validistes empêchent d’imaginer que l’enfant handi·e (ou l’adulte devenu·e handicapé·e) puisse avoir un futur : on encourage les parents à « faire leur deuil » alors que leur enfant est vivant [10] ; on plaint l’accidenté·e de la route dont « la vie s’est arrêtée ».
Comme le remarque Alison Karfer au tout début de Feminist Queer Crip : « Je n’ai jamais demandé à une diseuse de bonne aventure de me lire l’avenir. Personne n’a jamais consulté des feuilles de thé ni des étoiles pour moi, et personne n’a jamais lu les paumes de mes mains. Mais cela fait des années que les gen·te·s ne cessent de prédire mon avenir. Nul besoin de biscuits de fortune ou de cartes de tarot : mon fauteuil roulant, les cicatrices sur ma peau brûlée, les nœuds de mes mains leur disent apparemment tout ce qu’iels ont besoin de savoir. Mon futur est écrit à même mon corps [11]. » Apprendre à dédire les promesses ou les sombres avenirs qu’on croit lire sur le corps (ce morceau de matière vu du dehors auquel on assigne un genre, une classe, une race, un âge, une capacité, d’un seul coup d’œil, sans avoir à y réfléchir, en une milliseconde), voilà l’une des leçons puissamment invitées par les prophéties crip de Leah Lakshmi Piepzna-Samarasinha, qui propose d’imaginer
« non pas juste un futur où les personnes handicapées ont le droit d’exister (du genre : ok, super, il y a un mec blanc en fauteuil, c’est beau la diversité), mais un futur profondément dévalidé : un futur où les corps et les esprits handis, Sourds, Fous, neurodivergents sont à la fois acceptés sans autre forme de procès comme appartenant au spectre des manières humaines et animales d’exister, mais où nos cultures, nos savoirs, nos communautés donnent sa forme au monde. À quoi ressemblerait le futur si la majorité des genxtes étaient handi·es, neurodivergent·es, Sourdxs ou Fol·les ? À quoi ressemblerait un monde radicalement informé par les savoirs, les cultures, les amours et les manières handies de faire des liens ? A-t-on jamais essayé d’imaginer un tel monde sur un mode qui ne serait ni de l’ordre du fantastique ou de l’horreur, ni de l’ordre du récit édifiant, mais sur le mode du rêve ? » (p. 23)
Relevons, pour la suite de cet article, quelques-unes des formes que ce rêve d’un futur dévalidé prend dans le livre.
Les futurs dévalidés sont d’abord inscrits dans l’histoire longue des SF/spéculations féministes de nombreux·ses auteurices noir·es et racisé·es. Piepzna-Samarasinha cite ainsi « Octavia Butler, Larissa Lai, Nalo Hopkinson, Nnedi Okorafor, Rivers Solomon, Thirza Cuthand, the Metropolarity collective (Ras Mashramani, Alex Smith, Rasheedah Phillips, and M. Téllez), et Cherie Dimaline, pour n’en nommer que quelques-unes » (p. 30), autant d’auteurices qui mettent les pandémies, les transfections interespèces, le handicap au centre de ce que cela pourrait vouloir dire que d’habiter sur une planète blessée. De Lauren Olamina (la meneuse charismatique hyper-empathe et fibromyalgique d’une communauté religieuse dans La parabole du semeur et La parabole des talents d’Octavia E. Butler) à Onyeonswu (une survivante de viol qui utilise sa magie et ses talents de survivante pour reconstituer les clitoris excisés dans Qui a peur de la mort ? de Nnedi Okarafor), tout un ensemble de figuration des savoir-survivre et de l’invention de vies au bord du monde valide parsèment ainsi ces romans, qui, au rebours de l’héroïsme individualiste, présente des formes de solidarités collectives.
C’est que, comme le dit Walidah Imarisha dans sa préface à Octavia’s Brood : Science Fiction Stories from Social Justice Movements, une anthologie SF justement dédiée à donner la plume aux militant·es handies, queer et racisé·es : les vies noir·es, brun·es, trans* et crip d’aujourd’hui sont elles-mêmes des sciences-fictions : « nos ancêtres nous ont rêvé·es et iels ont changé la réalité pour nous rendre possibles [12]. » Et c’est pourquoi il est essentiel de développer des espaces de pratique pour rêver et décrire ensemble les futurs dévalidés qui nourrissent nos actions.
Le second rêve actif que renomme The Future Is Disabled s’inscrit dans la continuité de Care Work : c’est celui des pratiques d’entraide et d’interdépendances crip. Piepzna-Samarasinha détaille avec précision la manière dont l’entraide crip permet de sortir du modèle caritatif, où les handi·es sont, au mieux, réduit·es à des « objets de soin » qui reçoivent l’aide des valides, et au pire, entièrement relégué·es hors de la société valide.
Être un « objet de soin » de la société valide, cela veut dire souvent devoir « performer » le fait d’être de « bon·nes » handicapé·es, de se limiter à ne demander que ce qui concerne le fonctionnel. Être un « objet de soin » des valides, c’est aussi devoir médier leurs « paniques » quand iels ne savent pas comment gérer la manière dont les rythmes crip distordent leurs projets. Dans tous les cas, dans le paradigme caritatif-médical, les personnes handies sont structurellement privé·es d’être envisagé·es comme des membres actif·ves d’une communauté capable de solidarité. « Il n’y a pas de communauté handie ici » (p. 106) : une phrase que non seulement les valides, mais aussi les crip, encouragé·es à masquer leur handicap ou à ne pas sortir de chez elleux, sont souvent amené·es à prononcer, les coupant de soins communautaires et de solidarités moins asymétriques que celles parfois déployées par la société validiste.
L’activiste crip Zig Blanquer a proposé de remarquables réflexions sur la manière dont les dépendances handies fonctionnent et les formes d’autonomies qui peuvent s’inventer à l’intérieur de ces dépendances. Dans « Fait mains », il pense notamment les implications somatiques, haptiques et politiques d’être entouré d’aidant·es valides et la multiplication des organes à sentir qui en résulte, « d’où il devient indiscernable au bout d’un certain temps, de vouloir définir une propriété du geste [13]. » Et Blanquer souligne comment la précarisation des travailleureuses du soin et l’absence d’autonomie des personnes handicapées à choisir leurs aidant·es donnent forme à cette dépendance : « De plus en plus, ces dernières années, des mains d’organismes institutionnels par procuration en viennent jusqu’à me toucher. Elles m’atteignent par l’entremise d’une main d’œuvre obligée par pôle emploi, mains d’inadvertances intérimaires, mains bien trop menottées à leur propre survie précarisée. »
À rebours de cette impuissance instituée et en direction de formes d’interdépendances moins unilatérales, l’entraide handie que pointe Piepzna-Samarasinha agit à un niveau local, presque-invisible :
« Nos soins et notre compassion fleurissent aux creux de brefs instants de complicité crip. [...] L’espace crip est (souvent) un petit espace. Et la petitesse est parfois plus agile et plus agissante ; ça tombe bien, c’est l’échelle à laquelle existent les réseaux crip où notre confiance se construit. […] Souvent, le genre de truc qu’on fait, c’est : un groupe de trois personnes qui prennent des nouvelles les unes des autres. Il y a quelques années, j’ai des ami·es de Seattle qui ont créé un groupe Kripsignal sur Signal. On l’utilise pour prendre des nouvelles quand il y a des événements climatiques, des incendies, des chutes de neige, et pour trouver des manières de se venir en aide. […] Avec l’entraide handie, ce qu’on fait pour se venir en aide n’emprunte pas aux tropes dramatiques du genre “venir à la rescousse des malheureux”. Notre entraide est préventive, ordinaire, pleine d’amour. Notre entraide, c’est une manière handie de percevoir et de prendre soin les unes des autres. » (p. 65-66)
Dans un article déjà vieux de dix ans, Mia Mingus avait détaillé avec précision ce qu’elle appelait alors l’« intimité d’accès » (access intimacy) : le sentiment particulier que tu ressens quand quelqu’un·e d’autre semble comprendre tes besoins en termes d’accessibilité (tu aurais besoin que les lumières soient moins fortes, ou de faire une pause pour reprendre ton souffle, ou de quelqu’un·e pour t’accompagner aux toilettes…). Or, ajoute Piepzna-Samarasinha, cette « intimité d’accès » s’entraîne : ce n’est pas un talent inné, ce n’est pas quelque chose que tu acquiers seulement du fait d’avoir toi aussi traversé des moments crip similaires ; c’est une forme d’attention qui s’apprend et qui ne cesse de s’apprendre, et qui est au cœur des mutualismes handis. Préparer le futur exige de la pratique.
Un troisième lieu des rêves dévalidés est formé par les pratiques artistiques et par l’écriture qui jouent un rôle dans le développement de formes d’attention mutualistes. C’est l’objet de la deuxième section du livre, « Les histoires qui nous maintiennent en vie : les arts et la justice handie », où Piepzna-Samarasinha s’intéresse notamment à un événement artistique pré-pandémie organisé au Whitney Museum en 2019, I wanna be with you everywhere (IWBWYE), une série de performances auquel l’auteurice participe aux côtés d’autres artistes handies comme Eli Clare, John Lee Clark, Kayla Hamilton, Johanna Hedva, Jerron Herman, Cyrée Jarelle Johnson, Camisha L. Jones, Jordan Lord, NEVE, et Alice Sheppard (soit une vaste majorité d’artistes crip Noir·es, racisé·es, queer et trans*).
Réfléchissant à la nécessité d’inventer des manières de faire de l’art qui soient soucieuses des dynamiques d’accessibilité (sous-titrage, langage des signes, lits et autres sièges alternatifs à la chaise, ajustement des lumières, pauses fréquentes entre les performances, etc.), Leah Lakshmi Piepzna-Samarasinha pense aussi à la question de ce que cela impliquerait de faire des archives crip de l’art. Ielle se commet ainsi à renommer les artistes et les écrivaines racisé·es qui, sans utiliser le mot de handi ou de crip, ont centré leurs travaux sur l’expérience du handicap : d’Audre Lorde, « lesbienne Noire poétesse guerrière et mère, aveugle (au sens légal) et vivant avec le cancer, dont le travail brille des savoirs qu’elle a su collecter en vivant avec une différence corporelle et en ayant à se battre contre le complexe médico-industriel », à Gloria Anzaldúa, « maestra queer latinx qui a eu ses premières règles à trois ans et qui vécut avec des différences corporelles et reprogénitales », à Marsha P. Johnson et Sylvia Rivera, à Chrystos et Sapphire, pour qui le travail de « rendre visible le handicap dans leur vie et dans leur œuvre reste à faire, même si elles n’utilisaient pas ce concept, en partie en raison de la blanchité du mouvement pour les droits civiques handis à l’époque » (p. 201-202). En soulevant des questions de bibliographie, Piepzna-Saramasinha soulève plus que des questions d’histoire de la littérature : ce qui est aussi en jeu, c’est l’existence de sections « études handies » dans les librairies et les bibliothèques, et la possibilité de trouver des ressources autrement brutalement éparpillées entre les sections « santé », « biographie », « témoignage », « féminisme », « activisme », offrant l’image trompeuse d’une culture inexistante. Soi disant, encore : « il n’y a pas de communauté handie ici ».
En renommant les « histoires qui nous maintiennent en vie », Leah Lakshmi Piepzna-Samarasinha fait ainsi œuvre de « doula crip » :
« un terme créé par la militante pour la justice handie Stacey Park Milbern pour décrire les manières dont les personnes handicapées soutiennent/font office de mentor pour les personnes nouvellement handicapées dans leur apprentissage des savoir-faire handis (comment vivre avec un très petit nombre de cuillers, utiliser son fauteuil roulant, avoir du sexe/redéfinir la sexualité). Une doula soutient les personnes qui font le travail de donner naissance ; une doula crip est une personne handie qui soutient une autre personne handie qui fait le travail de devenir handicapée (ou différemment capable) et de rêver une nouvelle vie/un nouveau monde handis. Voilà une manière collective bien handie Noire et brune de faire le travail. » (p. 22)
S’assurer qu’il y ait des histoires à raconter, qu’il y ait des manières de se dire autrement que sous l’angle de la société valide, voilà ce que permet la poésie handie, et le travail de la rehausser sur nos rayons de bibliothèques.
Le soin, le deuil, l’accompagnement, l’entraide, les savoirs handis, oui, mais pas sans l’amour ni l’érotique. C’est sur la « Joie sauvage des estropié·es : un activisme du plaisir handi » que se presque-termine le livre, un chapitre où Leah Lakshmi Piepzna-Samarasinha reprend et élargit la contribution qu’iel avait déjà livrée à l’anthologie Pleasure Activism. The Politics of Feeling Good d’adrienne maree brown. Paru en 2019, Pleasure Activism rassemblait des écrits d’activistes féministes Noir·es et racisé·es autour des pratiques de plaisir et de joies militantes : un certain refus de sacrifier le présent dans lequel on vit aux futurs auxquels on rêve ; une certaine insistance à habiter l’Eros de la lutte et du soin que nous nous y pouvons apporter les unes aux autres.
Offrant une lecture crip de l’activisme du plaisir, Piepzna-Samarasinha soulève les critiques de certain·es ami·es marxistes à l’égard de l’usage individualiste du concept de plaisir militant, où « le bien être individuel et l’hédonisme sont mis en avant au milieu d’un monde en flammes, et en l’absence de toute analyse de classe quant à qui a la possibilité d’accéder à certains plaisirs, et comment se définit le plaisir en fonction de ce qu’il coûte » (p. 308). Pour autant, ielle se refuse à laisser le plaisir, l’érotique, l’art de se reposer et de prendre soin de soi au capitalisme extractiviste et aux rayons bien-être des grandes surfaces. Et ielle insiste pour qu’on n’oublie pas
« les siesteuses originelles, à savoir : les personnes handies, y compris un paquet de personnes handicapées pauvres, et en particulier les personnes handies qui avons des corps qui ne nous laissent pas d’autre choix que de nous reposer massivement, surtout si nous sommes pauvres. » (p. 309)
Savoir s’organiser pour trouver des minutes de repos dans une journée parce que de toute façon, on ne pourrait pas en faire plus, voilà un art bien handi qui n’a pas grand-chose à voir avec les power naps des grandes entreprises, et qui est plutôt une manière de faire insister, dans le monde, autre chose que les rythmes du productivisme.
« Oser avoir une érotique handie » n’est pas la chose la plus facile quand le biopouvoir qui s’exerce sur ton corps ne vise qu’à réparer sa « fonctionnalité » et ne juge toute ornementation, tout plaisir, toute esthétique que comme un luxe. « Qu’on pense à la laideur de la plupart des équipements médicaux – et comment, jusqu’à récemment, la plupart des prothèses et des dispositifs d’assistance n’étaient proposées que dans des teintes de peau claires, ou se limitait à leur fonctionnalité, jamais pensée pour être belles. » (p. 312) Comme l’ont montré Paul B. Preciado (dans Le manifeste contrasexuel) et Gayle Rubin (dans Surveiller et jouir), de nombreuses pratiques cuir, en particulier les pratiques BDSM, proviennent d’un réinvestissement des prothèses et des dispositifs médicaux utilisés pour « soigner » ou « corriger » les déviances sexuelles : du godemichet employé par les médecins pour soigner les femmes hystériques (censément en manque de sexe) en les pénétrant « médicalement », aux seringues et aux restrictions employées dans les asiles psychiatriques, tout un ensemble de manières déviantes de faire du sexe consiste à se réapproprier des dispositifs crip.
Mais « l’érotique handie », c’est aussi des types de plaisir moins évidemment liés à la sexualité valide et à ses jeux avec le médical. Comme l’écrit C. K. Kaufman (citée p. 312) à propos de la manière dont la pandémie de Covid-19 a contribué à redéfinir sa sexualité crip :
« ça ressemble à des dynamiques kink qui se développent au long de messages audios, et de textes, et d’une tonne d’images de moi nue.
ça ressemble à rompre avec mon amoureux au printemps 2021 quand il a décidé de sortir en boîte plutôt que de prendre soin de ma sécurité/de mes besoins.
ça ressemble à lutter pour écrire des recensions de sex toys parce qu’on n’est pas d’humeur à les essayer.
ça ressemble à ne pas savoir quand je vais pouvoir me lover dans les bras d’une amie.
ça ressemble à lire des nouvelles érotiques à mes ami·es au téléphone.
ça ressemble à prendre soin de moi et de ma peau autrement.
ça ressemble à faire ressortir et sentir la profondeur des effets de la violence sexuelle et du traumatisme dans mon corps, et essayer de savoir ce dont j’ai besoin pour lutter contre la douleur qu’elles renferment.
ça ressemble au travail d’indéfinir et de redéfinir ma sexualité.
ça ressemble à faire des détours avec mon fauteuil pour que les feuilles de ma plante d’appartement me caressent la joue [14]. »
Criper l’érotique dans ce sens, c’est certes érotiser les corps crip, comme la collective de performeureuses handies queer et racisé·es Sins Invalid le fait depuis 2005, avec son esthétique camp, ses couleurs pimpantes et son érotique genderqueer ultrafèm, armée du slogan : An Unashamed Claim to Beauty in the Face of Invisibility, « Sans honte, la revendication de la beauté face à l’invisibilité ». Mais c’est aussi s’engager « au-delà d’une politique de la désirabilité », comme le dit Mia Mingus dans « Vers le moche », et refuser la validation des normes validistes de beauté. « La société veut nous “intégrer”, et pour cela elle nous demande de ne pas attirer l’attention sur nous. Mais que se passe-t-il si nous résistons à ce désir de la société de nous rendre invisibles ? Que se passe-t-il si, en changeant nos manières d’y apparaître, nous refusons collectivement son assimilation ? » (cité p. 319)
Répondant à cet appel, Piepzna-Samarasinha conclut le chapitre dédié à l’activisme du plaisir handi sur ce qu’ielle appelle « l’érotique du décamouflage » (erotics of unmasking) : une invitation à considérer ce qui se passe quand tu ne te sens plus forcée de « masquer » tes tocs, tes stims, les bouts de toi que la société valide ne veut pas voir.
« Notre activisme du plaisir crip est un poing dans la face de toustes celleux qui disent que nous ne méritons que l’utilité, sécurisées dans une institution, munies des vêtements les plus basiques, mais jamais l’euphorie de genre, qui veulent bien notre survie, mais pas nos plaisirs. Nous créons des mouvements et nous imaginons des futurs à partir de nos érotiques handies et neurodiverses – des érotiques pleines non seulement de survie, mais aussi remplies de plaisirs et de joies.
Le travail d’imaginer un futur radicalement dévalidé doit être guidé par cette joie sauvagement handie que nous inventons quand nous nous battons pour le présent.
Notre érotique handie est puissante. » (p. 326)
Célébrant les manières pas-droites d’être et de vivre ensemble, le livre de Leah Lakshmi Piepzna-Samarasinha déniche dans les ruines du capitalisme, au creux de ses systèmes de mort, des formes vies « sauvagement handies » dont nous avons toustes, habitantes d’une Terra en voie d’épuisement, urgemment besoin d’apprendre.
EMMA BIGÉ
[1] Handicapés méchants, n° 1, 1974, p. 1 ; https://archivesautonomies.org/spip.php?article9
[2] N’étant moi-même pas très habituée du genre de l’autothéorie, je peux cependant dire ceci pour me situer : malgré, apparemment, les efforts les plus anciens (je croisais déjà les jambes pour cacher mon sexe à l’échographie, si bien qu’on s’attendait à voir débarquer une « petite fille »), on m’a assignée – et convaincue l’essentiel de mon existence que j’aurais tout intérêt – à devenir un cismecblanchétérobourgeoisvalide, ce que Sylvia Wynter a appelé « Homme1 ». À force de désidentifications et de transitions de différentes sortes, et passant de moins en moins pour Homme1, (bien que toujours bénéficiant de certains avantages de la blanchité), je me demande ce que la catégorie d’« affection longue durée » (spécifiquement l’« ALD 31 Transidentité » qui autorise au remboursement des hormones et de l’épilation au laser) peut faire à ma supposée validité. Et je me demande aussi, avec Eva Hayward et Jasbir K. Puar, quelles alliances trans/crip sont susceptibles de m’apprendre davantage à moins me fantasmer comme valide, ou alors seulement par intermittence – et de toute façon, pas pour très longtemps (puisque bientôt, la sénescence de mes cellules me fera bien voir que la norme de santé qui s’associe à ma jeunesse n’est qu’un manque d’imagination âgiste). J’hésite et je crains d’endosser une désignation (handie, estropiée, folle) qui me paraît requérir quelque chose de « grave » ou de plus impactant que ma désidentité de genre, ma neurowyrdness, mes hyperacousies, ma musicophobie, mon empathie exagérée pour les affects des autres, mon incapacité à rester en place sur une chaise ; et je me rends compte que ce qui m’empêche de me reconnaître comme crip est précisément ce que les théoricien·nes crip décrivent comme une représentation validiste du handicap : l’idée que le handicap serait l’envers de la vie ordinaire ; qu’handiE, estropieé ou fol·le, on ne pourrait pas rayonner d’une vie, d’un milieu, d’un monde complet. Alors, face à ces questions, tout ce que je peux dire, c’est que je me sens concernée par, conspirant avec, et complice de tout ce qui vise à invalider/dévalider l’idée qu’il n’y aurait qu’une seule manière d’être complètes, tout ce qui vise à nous apprendre, au contraire, que nous sommes toustes (nous, habitant·es de Terra) bien plus incomplètes que l’individualisme méthodique du capitalisme ne veut nous forcer à le croire.
[3] Arachné Rae, « Open letter to disabled lesbians », Off Our Backs, vol. 11(5), 1986, p. 39, citée in Adrien Primerano, « L’émergence des concepts de “capacitisme” et de “validisme” dans l’espace francophone. Entre monde universitaire et monde militant », Alter. European Journal of Disability Research, vol. 2, 2022.
[5] Talila A. Lewis, « Working Definition of Ableism », janvier 2022 ; https://www.talilalewis.com/blog/working-definition-of-ableism-january-2022-update
[6] Loree Erickson, « Revealing femmegimp », Atlantis, vol. 31/2, 2007.
[7] Sur la notion de justice handie, cf. https://www.sinsinvalid.org/blog/10-principles-of-disability-justice
[8] Mia Mingus, « Nos mort·es ne vous sont pas du·es. Covid, suprématie validiste et interdépendance », traduit de l’anglais (États-Unis) par Unai Aranceta et Elvina Le Poul, Jeff Klak, 3 février 2022.
[9] cf. Lee Edelmann, Merde au futur. La théorie queer et la pulsion de mort, EPEL, 2016 ; et là-dessus, Diva, « La structure du queer », Trou noir, #18, 2021
[10] Jim Sinclair, « Ne nous pleurez pas » [Our Voice, vol. 1(3), 1993], traduit de l’anglais (Canada) sur asperansa.org. Merci à Anaïs Ghedini pour cette référence.
[11] Alison Kafer, Feminist Queer Crip, Indiana UP, 2013, p. 1
[12] Walidah Imarisha, « Introduction » à Octavia’s Brood : Science Fiction Stories from Social Justice Movements, dirigé par Walidah Imarisha and adrienne maree brown, Chico, AK Press, 2015, p. 3-5 : « L’activisme est une science-fiction. Les militant·es dédient leurs vies à créer et à envisager un autre monde, ou une multitude d’autres mondes. […] Et pour celleux d’entre nous qui appartenons à des communautés traumatisées par des siècles d’histoires collectives, nous devons comprendre que nous sommes déjà, chacune d’entre nous, des sciences-fictions en chair et en os. Nos ancêtres nous ont rêvé·es et iels ont changé la réalité pour nous rendre possibles. »
[13] Zig Blanquer, « Fait mains », Jeff Klak, n° 4, 2017, repris dans Nos existences handies, Nantes, Monstrograph, 2022.
[14] Dans le même sens, Zig Blanquer adressait en 2006 une lettre ouverte au journal Gendertrouble pour montrer le validisme à l’œuvre qui insiste à l’intérieur de certains imaginaires de la déviance queer – toute une « gestuelle non-dite, d’évidence conforme » qui n’est « questionnée nulle part dans ce que j’ai pu lire de vous-même qui prétendez justement déconstruire la pratique de vos corps et vos désirs. » Critiquant notamment les modèles valides de certains empouvoirements queer (la masturbation comme représentation d’une autonomie sexuelle réussie, la sexualité toride « dans tous les sens », la backroom en bas des marches…), Zig Blanquer insiste pour penser une sexualité queer/crip moins prisonnière de l’imaginaire qui se satisfait de l’inversion (des genres), de l’intensification (des actes), ou de la multiplication (des partenaires), formes qui, pour « déconstructrices » qu’elles puissent être, tombent dans l’écueil d’un renversement oppositionnel du normatif qui ne fait que le reproduire : « moi et mon corps handi, immobile et ultrasensible de plaisirs & de douleurs, on n’a pas grand chose à déconstruire ; parce que cette société est architecturée pour les valides, configurée pour leurs corps efficaces, cadencée pour leurs mouvements équilibrés, accessibilisée pour leurs rencontres et contacts, organisée pour leurs plaisirs. mes fists n’ont rien à y é/branler. » (Zig Blanquer, « Vos désirs sont des échos ou des égos », Gendertrouble, 26 mai 2006.)
Un entretien avec Bash Back ! réalisé par CrimethInc et un appel à la convergence
« Ce que j’entends dans trans* et non-binaire, c’est un appel, un appel aux armes, un appel à la solidarité, à la coalition, à une logique bien plus large de refus généralisé »
